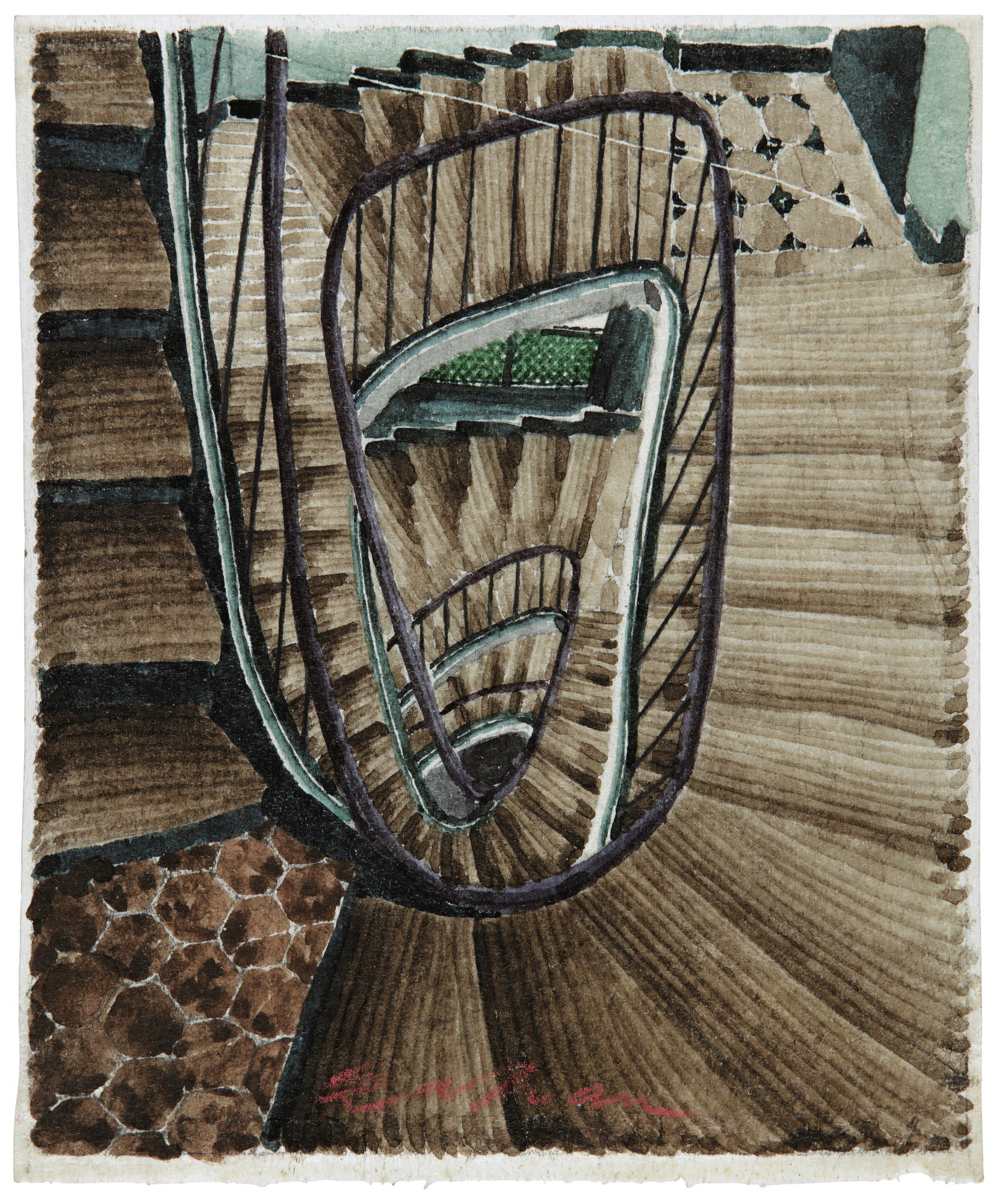
Montaigne, Essais, I, 26, « De l’institution des enfants » A quoi sert la lecture ?
Extrait 1 :
Pour un enfant de maison noble qui recherche l’étude des lettres, non pour le gain (car un but aussi vil est indigne de la grâce et de la faveur des Muses ; d’autre part il concerne les autres et dépend d’eux), ni autant pour les avantages extérieurs que pour les siens propres et pour qu’il s’enrichisse et s’en pare au-dedans, moi, ayant plutôt envie de faire de lui un homme habile. qu’un homme savant, je voudrais aussi qu’on fût soucieux de lui choisir un guide qui eût plutôt la tête bien faite bien pleine et qu’on exigeât chez celui-ci les deux qualités, mais plus la valeur morale et l’intelligence que la science, et je souhaiterais qu’il se comportât dans l’exercice de sa charge d’une manière nouvelle. On ne cesse de criailler à nos oreilles d’enfants, comme si l’on versait dans un entonnoir, et notre rôle, ce n’est que de redire ce qu’on nous a dit. Je voudrais que le précepteur corrigeât ce point de la méthode usuelle et que, d’entrée, selon la portée de l’âme qu’il a en main, il commençât à la mettre sur la piste [1], en lui faisant goûter les choses, les choisir et les discerner d’elle-même, en lui ouvrant quelquefois le chemin, quelquefois en le lui faisant ouvrir. Je ne veux pas qu’il invente et parle seul, je veux qu’il écoute son disciple parler à son tour. Socrate et, depuis, Arcésilas [2] faisaient d’abord parler leurs disciples, et puis ils leur parlaient. « Obest plerumque iis qui discere volunt auctoritas eorum qui docent [3]
Il est bon qu’il le fasse trotter devant lui pour juger de son allure, juger aussi jusqu’à quel point il doit se rabaisser pour s’adapter à sa force. Faute d’apprécier ce rapport, nous gâtons tout : savoir le discerner, puis y conformer sa conduite avec une juste mesure, c’est l’une des tâches les plus ardues que je connaisse ; savoir descendre au niveau des allures puériles du
disciple et les guider est l’effet d’une âme élevée et bien forte. Je marche de manière plus sûre et plus ferme en montant qu’en descendant. Quant aux maîtres qui, comme le comporte notre usage, entreprennent, avec une même façon d’enseigner et une pareille sorte de conduite, de diriger beaucoup d’esprits de tailles et formes si différentes, il n’est pas extraordinaire si, dans tout un peuple d’enfants, ils en rencontrent à peine deux ou trois qui récoltent quelque véritable profit de leur enseignement. Qu’ils ne demande pas seulement à son élève de lui répéter les mots de la leçon qu’il lui a faite, mais de lui dire leur sens et leur substance, et qu’il juge du profit qu’il en aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais par celui de sa vie. Ce que l’élève viendra apprendre, qu’il le lui fasse mettre en cent formes et adaptées à autant de sujets différents pour voir s’il l’a dès lors bien compris et bien fait sien, en réglant l’allure de sa progression d’après les conseils pédagogiques de Platon [4].
Regorger [5] la nourriture comme on l’a avalée est une preuve qu’elle est restée crue et non assimilée. L’estomac n’a pas fait son œuvre s’il n’a pas fait changer la façon d’être et la forme de ce qu’on lui avait donné à digérer.
Extrait 2 :
Qu’il lui fasse tout passer par l’étamine [6] et ne loge rien en sa tête par simple autorité et à crédit ; les principes d’Aristote ne lui soient principes, non plus que ceux des Stoïciens ou Epicuriens. Qu’on lui propose cette diversité de jugements : il choisira s’il peut, sinon il en demeurera en doute. Il n’y a que les fols certains et résolus.
Che non men che saper dubbiar m’aggrada*
Car s’il embrasse [7] les opinions de Xénophon et de Platon par son propre discours, ce ne seront plus les leurs ce seront les siennes. Qgi suit un autre, il ne suit rien. Il ne trouve rien, voire il ne cherche rien. « Non summus sub rege ; sibi quisque se vindicet**. » Qu’il sache qu’il sait, au moins. [ ... ] La vérité et la raison sont communes à un chacun et ne sont non plus à qui les a dites premièrement, qu’à qui les dit après. Ce n’est non plus selon Platon que selon moi, puisque lui et moi l’entendons et voyons de même.
Les abeilles pillotent [8] deça delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur ; ce n’est plus thym ni marjolaine : ainsi les pièces empruntées d’autrui, il les transformera et confondra, pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement.
* Emprunté à Dante, L’Enfer, chant XI ; « Aussi bien que savoir douter me plaît."
** Sénèque, lettre 33 : « Nous ne sommes pas sous la domination d’un roi ; que chacun dispose de soi-même."
Livre l, chapitre XXVI, « Sur l’éducation des enfants ", adapté et traduit du français du XVIe siècle par A. Lanly © éd. Champion, 1989.
Lire selon Descartes
« Je savais que les langues qu’on y apprend sont nécessaires pour l’intelligence des livres anciens ; que la gentillesse des fables réveille l’esprit ; que les actions mémorables des histoires le relèvent, et qu’étant lues avec discrétion elles aident à former le jugement ; que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés, qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleures de leurs pensées ; que l’éloquence a des forces et des beautés incomparables ; que la poésie a des délicatesses et des douceurs très ravissantes ; que les mathématiques ont des inventions très subtiles, et qui peuvent beaucoup servir tant à contenter les curieux qu’à faciliter tous les arts et diminuer le travail des hommes ; que les écrits qui traitent des mœurs contiennent plusieurs enseignements et plusieurs exhortations à la vertu qui sont fort utiles ; que la théologie enseigne à gagner le ciel ; que la philosophie donne moyen de parler vraisemblablement de toutes choses, et se faire admirer des moins savants […]. » (Discours de la méthode, AT VI, p. 5-6)
Comment un homme qui affirmait ne pas lire et ne pas avoir besoin de livres pouvait-il prétendre au statut de philosophe ? Un philosophe qui ne lit pas : tel est le paradoxe que Baillet doit éclaircir, à un moment où un philosophe se définit encore principalement comme un érudit et, selon la formule de l’époque, comme un homme « de grande lecture »
Lire : VOLPILHAC, Aude. « Lire selon son esprit » Le lecteur cartésien selon Adrien Baillet In : Qu’est-ce qu’être cartésien ? [en ligne]. Lyon : ENS Éditions, 2013 . ISBN : 9791036200298. DOI : https://doi.org/10.4000/books.enseditions.8830
EXERCICE /
Expliquer un texte : Simone de Beauvoir. Ce que la lecture fait à l’âme humaine :
Sur EDUSCOL Texte 12 : Ce que la lecture fait à l’âme humaine. Vous trouverez sur le lien des éléments de commentaire.
• Mots-clés : existence, travail, lecture, représentation, langage.
• Repères : universel/général/particulier/singulier, concept/image/métaphore.
« Aujourd’hui ma vie est faite, mon œuvre est faite, même si elle doit encore se prolonger : aucun livre ne saurait m’apporter de foudroyante révélation. Pourtant je continue à lire, beaucoup : le matin, l’après-midi avant de me mettre au travail ou quand je suis fatiguée d’écrire ; si par hasard je passe une soirée seule, je lis ; l’été à Rome, je lis pendant des heures. Aucune occupation ne me semble plus naturelle. Pourtant, je m’interroge : si plus rien de décisif ne peut m’arriver par les livres, pourquoi est-ce que j’y demeure si attachée ?
La joie de lire : elle ne s’est pas émoussée. Je suis toujours émerveillée par la métamorphose des petits signes noirs en un mot qui me jette dans le monde, qui précipite le monde entre mes quatre murs. Le texte le plus ingrat suffit à provoquer ce miracle. J.F. 30 ans, sténo-dactylo exp. ch. travail trois jours par semaine. Je suis des yeux cette petite annonce et la France se peuple de machines à écrire et de jeunes chômeuses. Je sais : le thaumaturge, c’est moi. Si devant les lignes imprimées je demeure inerte, elles se taisent ; pour qu’elles s’animent, il faut que je leur donne un sens et que ma liberté leur prête sa propre temporalité, retenant le passé et le dépassant vers l’avenir. Mais comme au cours de cette opération je m’escamote, elle me semble magique. Par moments, j’ai conscience que je collabore avec l’auteur pour faire exister la page que je déchiffre : il me plaît de contribuer à créer l’objet dont j’ai la jouissance. Celle-ci se refuse à l’écrivain : même quand il se relit, la phrase née de sa plume se dérobe à lui. Le lecteur est plus favorisé : il est actif et cependant le livre le comble de ses richesses imprévues. La peinture, la musique suscitent en moi, pour la même raison, des joies analogues ; mais les données sensibles y jouent un rôle immédiat plus important. En ces domaines, je n’ai pas à effectuer le surprenant passage du signe au sens qui déconcerte l’enfant quand il commence à épeler des mots et qui n’a pas cessé de m’enchanter. Je tire les rideaux de ma chambre, je m’étends sur un divan, tout décor est aboli, je m’ignore moi-même : seule existe la page noire et blanche que parcourt mon regard. Et voilà que m’arrive l’étonnante aventure relatée par certains sages taoïstes : abandonnant sur leur couche une dépouille inerte, ils s’envolaient ; pendant des siècles ils voyageaient de cime en cime à travers toute la terre et jusqu’au ciel. Quand ils retrouvaient leur corps, celui-ci n’avait vécu que le temps d’un soupir. Ainsi je vogue, immobile, sous d’autres cieux, dans des époques révolues et il se peut que des siècles s’écoulent avant que je me retrouve, à deux ou trois heures de distance, en ce lieu d’où je n’ai pas bougé. Aucune expérience ne peut se comparer à celle-là. À cause de la pauvreté des images, la rêverie est inconsistante, le dévidage des souvenirs s’épuise vite. Reconstruire le passé par un effort dirigé, c’est un travail qui ne donne pas plus que la création la jouissance de son objet. Spontanée ou sollicitée, la mémoire ne m’apprend jamais que ce que je sais. Mes rêves m’étonnent davantage ; mais au fur et à mesure qu’ils se déroulent, ils s’effilochent et le souvenir en est décevant. Seule la lecture avec une remarquable économie de moyens – juste ce volume dans ma main – crée des rapports neufs et durables entre les choses et moi. »
Simone de Beauvoir, Tout compte fait, Ed. Gallimard, 1972, pp. 157-158.
Etude d’un texte de Paul Ricoeur :
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE.
La séance est ouverte à 16 h. 45 à la Sorbonne, Amphithéâtre Michelet, sous la présidence de M. Henri GOUHIER, vice-prési- dent de la Société.
M. Henri Gouhier. Le nombre d’auditeurs que la com- munication de M. Paul Ricoeur a attirés montre qu’il est assez connu et qu’une présentation serait tout à fait superflue. Je veux simplement le remercier, car avec ses cours de Nanterre, avec ses séminaires de la Sorbonne et ses multiples occupations, nous savons combien son emploi du temps est chargé, et nous sommes très heureux qu’il ait bien voulu venir ici pour exposer la partie la plus proprement philosophique de son dernier ouvrage, De l’interprétation, Essai sur Freud.
Avant de lui donner la parole, je présente les excuses de notre Président Jean Wahl qui est toujours à Tunis et de M. Olivier Lacombe qui n’a pas pu venir. La parole est à Paul Ricoeur.
M. Ricœur.
Mesdames, Messieurs, en remerciant Monsieur le Président pour ses paroles si amicales de bienvenue, je veux tout de suite l’assurer que je ne ferai pas de cette séance un plai- doyer pour un livre, mais plutôt une libre réflexion sur ses difficultés.
D’entrée de jeu, deux questions se posent :
1. Peut-on, comme je le propose, distinguer la lecture de Freud et une interprétation philosophique de Freud ?
2. A-t-on le droit de donner une interprétation philosophique qui consiste, comme je l’avoue dans mon argument, à reprendre son œuvre dans un autre discours, surtout si ce discours est celui de la philosophie réflexive ?
A la première question, je réponds en général et en particulier. Je réponds, en général, que l’histoire de la philosophie et la philosophie (ou, comme on dit en termes fâcheux, la philosophie générale) sont deux activités philosophiques distinctes. En ce qui concerne l’histoire de la philosophie, il s’est établi, je crois, un consensus tacite et exprès parmi les historiens de la philosophie sur l’espèce d’objectivité qui peut être atteinte dans cette discipline ; il est possible de comprendre un auteur par lui-même sans, pour autant, ni le déformer, ni le répéter ; j’ai employé un mot qui appartient à Monsieur Gueroult je parle de la reconstitution architectonique d’une œuvre. Mais je crois que tous les autres historiens même s’ils parlent, en un sens plus bergsonien, d’intuition philosophique admettent qu’il n’est pas possible de coïncider avec une ceuvre ; tout au plus peut-on la ressaisir à partir d’une constellation de thèmes que monnaye l’intuition et surtout à partir d’un réseau d’articulations qui en constituent en quelque sorte la substructure, la charpente sous-jacente ; c’est pourquoi on ne répète pas, mais on reconstruit. Mais, d’un autre côté, on ne falsifie pas l’oeuvre étudiée si on arrive à produire, à défaut d’un double de l’oeuvre, qui serait d’ailleurs inutile, un homologue, c’est-à-dire, au sens propre du mot, un objet vicaire présentant le même arrangement que l’œuvre. C’est dans ce sens que je parle d’objectivité, parce que, en un sens négatif de non-subjectivité, le philosophe met entre parenthèses ses propres convictions, ses propres prises de position et d’abord sa propre manière de commencer, d’attaquer et de disposer stratégiquement sa pensée ; objectivité, en un sens positif, parce que sa lecture est soumise à ce que veut et veut dire l’œuvre même, laquelle reste le quid qui règle sa lecture.
–
Eh bien, je dis que Freud peut être lu comme nos collègues et nos maîtres lisent Platon, Descartes, Kant. C’est, je l’avoue, un premier pari qui n’est pas forcément gagné : la référence de la doctrine à une expérience qui exige apprentissage et compétence, qui est un métier et même une technique, cette référence ne met-elle pas Freud tout à fait à part des penseurs et des philosophes cités plus haut ? Je continue de penser que l’objection n’est pas invincible, que la lecture de Freud ne pose pas de problème différent de ceux que rencontre la lecture de Platon, de Descartes, de Kant, et peut prétendre au même genre d’objectivité. Pourquoi ? D’abord parce que Freud a écrit une œuvre qui ne s’adresse pas à ses élèves, à ses collègues ou à ses patients, mais à nous tous en faisant des conférences, en publiant des livres, il a accepté d’être placé par ses lecteurs et ses auditeurs dans le même champ de discussion que les philosophes ; c’est lui qui a pris le risque ; ce n’est pas moi. Mais l’argument est encore trop contingent, trop lié aux aléas de la communication ; je prétends que ce qui apparaît dans la relation analytique n’est pas radicalement autre que ce que le non-analysé peut comprendre ; je dis bien comprendre et non pas vivre ; car nulle intelligence livresque ne sera jamais le substitut du cheminement effectif d’une psychanalyse ; mais le sens de ce qui est ainsi vécu est essentiellement communicable ; parce qu’elle est communicable, l’expérience analytique peut être transposée par la doctrine au plan de la théorie, à l’aide de concepts descriptifs relevant d’un second niveau de conceptualité ; de même qu’au théâtre je peux comprendre des situations, des sentiments, des conduites que je n’ai pas vécus, je peux comprendre, sur un mode de sympathie intellective, ce que signifie une expérience que je n’ai pas faite. C’est pourquoi, en dépit de graves malentendus que je ne sous- estime pas, il est possible à un philosophe de comprendre en philosophe la théorie psychanalytique et même partiellement l’expérience psychanalytique. Ajouterai-je un argument plus décisif encore ? c’est Freud qui est venu sur notre terrain. Comment ? eh bien, parce que l’objet de son investigation, ce n’est pas, comme on le dirait trop vite, le désir humain, le vou (Wunsch), la libido, la pulsion, Eros (tous ces mots ont un sens contextuel précis) ; c’est le désir, dans un rapport plus ou moins conflictuel avec un monde de la culture, avec un père et une mère, avec des autorités, avec les impératifs et les interdictions, avec des oeuvres d’art, des buts sociaux et des idoles ; c’est pourquoi, lorsque Freud. écrit sur l’art, la morale et la religion, il n’étend pas après coup à la réalité culturelle une science et une pratique qui auraient d’abord trouvé leur lieu déterminé dans la biologie humaine, ou dans la psycho-physiologie ; d’emblée sa science et sa pratique se tiennent au point d’articulation du désir et de la culture. Que l’on prenne l’Interprétation du Rêve, ou les Trois Essais sur la Sexualité, pour ne considérer que deux des premières oeuvres, le plan pulsionnel est pris dans sa relation avec une « censure », des « digues », des « interdictions » et des « idéaux » ; la figure nucléaire du père, dans l’épisode oedipien, est seulement le centre de gravitation de ce système. C’est pourquoi, dans la première, puis dans la deuxième topique, nous sommes d’emblée en face d’une pluralité de « lieux » et de « rôles », où l’inconscient est polairement opposé au conscient et au préconscient, où le ça est tout. de suite dans un rapport dialectique au moi et au sur-moi. Cette dialectique est celle même de la situation que la psychanalyse explore, à savoir l’entrelacs du désir et de la culture. Voilà pourquoi je disais que Freud est venu chez nous car, même lorsqu’il nous parle de pulsion, il nous en parle dans et à partir d’un plan d’expression, dans et à partir de certains effets de sens qui se donnent à déchiffrer et qui peuvent être traités comme des textes : textes oniriques ou textes symptomatiques ; oui, de textes qui surviennent dans le réseau des communications, des échanges de signes. C’est dans ce milieu des signes que se déploie précisément l’expérience analytique, en tant qu’elle est une œuvre de parole, un duel de parole et d’écoute, une complicité de parole et de silence. C’est cette appartenance, tant de l’expérience analytique que de la doctrine freudienne, à l’ordre des signes qui légi- time fondamentalement, non seulement la communicabilité de l’expérience analytique, mais son caractère homogène, en dernier ressort, à la totalité de l’expérience humaine que la philosophie entreprend de réfléchir et de comprendre.
Voilà les présupposés qui ont guidé ma décision de lire Freud comme je lis les autres philosophes.
Quant à cette lecture, je n’en dirai presque rien ici, puisque j’ai choisi de parler, devant la Société de philosophie, de l’interprétation philosophique que j’en propose ; je commenterai seu- lement ce que j’ai appelé reconstitution architectonique et don- nerai à dessein à l’exposé un tour plus systématique que je ne l’ai fait dans le livre.
L’œuvre de Freud me parait pouvoir être répartie en trois grandes masses qui ont chacune une architecture propre et qui peuvent être considérées comme trois niveaux conceptuels, qui trouvent leur expression la plus achevée dans des états de sys- tème que l’on peut enchaîner ensuite diachroniquement. Le premier réseau est constitué avec l’interprétation du rêve et du symptôme névrotique et aboutit, dans les Écrits de Métapsychologie, à l’état de système connu sous le nom de première topique (la série : moi, ça, sur-moi constituant plutôt, selon le mot de Lagache, une personnologie). La deuxième grande masse de faits et de notions, qui constitue le second réseau théo- rique, contient l’interprétation de la culture œuvres d’art, idéaux et idoles ; ce second réseau procède du précédent, en ce que celui-ci contenait déjà la dialectique du désir et de la cul- ture ; mais, en appliquant le modèle onirique de l’accomplissement de vœu à tous les effets de sens que l’on peut rencontrer dans la vie de culture, on est amené à remanier profondément l’équilibre atteint dans les Écrits de Méta-psychologie ; le résultat de ce remaniement est un second état de système, qui s’exprime dans la séquence moi, ça, sur-moi ; elle ne remplace pas la première, mais se superpose à elle. La troisième grande masse de faits. et de notions, qui constitue le troisième réseau théorique, procède des remaniements imposés par l’introduction des pulsions. de mort dans l’édifice antérieur ; ce remaniement atteint les assises de l’existence, puisqu’il s’agit d’une redistribution des forces en fonction de la polarité éros-thanatos ; mais, comme le rapport entre pulsion et culture reste le gros fil conducteur, ce remaniement à la base est aussi un remaniement au sommet ; l’entrée en scène de la pulsion de mort implique en effet la plus importante réinterprétation de la culture, celle qui s’exprime dans Malaise dans la Civilisation ; c’est dans la culpabilité, dans le malaise du civilisé, dans la clameur de la guerre que la pulsion muette vient à crier.
Voilà en gros l’architectonique du freudisme..
Comme on voit, il y a un développement, mais qui n’est compréhensible que si on procède d’état de système en état de système. On aperçoit alors une ligne sensée qui se déploie d’une représentation mécaniciste de l’appareil psychique à une dramaturgie romantique de la vie et de la mort. Mais ce développement n’est pas incohérent ; il procède par remaniements successifs de structures. Et cette suite de remaniements se produit à l’intérieur d’un milieu homogène, à savoir les effets de sens du désir. C’est ce milieu homogène de toutes les restructurations de la doctrine freudienne que j’ai appelé sémantique du désir.
Mais je veux en venir à l’objet principal de cette communication. Une interprétation philosophique de Freud. Je l’aborderai par la deuxième objection que l’on peut faire à une pareille entre- prise ; ne peut-on pas légitimement récuser toute tentative de reprendre une œuvre comme celle de Freud dans un autre dis- cours ? L’oeuvre de Freud, dira-t-on, est une totalité qui se suffit. à elle-même ; vous la faussez si vous la placez dans un autre champ de pensée que celui-là même qu’elle engendre. Cet argument une force considérable ; il vaudrait pour tout autre penseur : mais il a une force particulière dans le cas de Freud ; il est tou- jours possible de considérer l’entreprise philosophique qui pré- tendrait l’intégrer comme la suprême dénégation, la plus astu- cieuse des résistances. Cela est probablement vrai. J’estime pour- tant que l’objection, même victorieuse, ne règle pas le problème d’une interprétation philosophique de Freud.
Deux sortes d’arguments peuvent être avancées contre l’exclu- sivisme fanatique de certains freudiens. Je dirai d’abord qu’il est faux que Freud et la psychanalyse nous fournissent une tota- lité. Faut-il rappeler tous les textes où Freud déclare, sans ambi- guïté possible, qu’il n’a éclairé qu’un groupe de pulsions, celles qui qui étaient accessibles à sa pratique, et qu’en particulier le domaine du moi n’est qu’en partie exploré par celles des pulsions du moi qui appartiennent au même cycle que la libido d’objet ? La psy- chanalyse n’est qu’un rayon parmi d’autres jeté sur l’expérience humaine. Mais surtout
et cet argument se tire de la pratique. analytique elle-même il faut considérer la doctrine comme une mise en ordre, à partir de concepts construits et enchaînés en cohérence, d’une expérience qui est très particulière : l’expérience analytique ; il faut tenir ceci très fermement : c’est finalement dans l’enceinte de la relation analytique que se joue, c’est-à-dire à la fois se mime et se confirme, la conceptualisation freudienne ; or il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre qu’il n’y en a dans toute notre psychanalyse. J’ai dit tout à l’heure que cette expérience peut être comprise, qu’elle est homogène à l’expé- rience humaine dans sa totalité ; mais elle l’est précisément comme une partie dans un tout. La philosophie a vocation pour arbitrer non seulement la pluralité des interprétations, comme j’essaierai de le dire pour finir, mais la pluralité des expériences.
Ce n’est pas tout : non seulement la doctrine et l’expérience ana- lytique sont partielles, mais l’une et l’autre comportent une dis- cordance, une faille, qui appelle l’interprétation philosophique. Je pense ici au décalage qui existe entre la découverte freudienne et la conceptualité mise en œuvre par le système. Cela est sans doute vrai de toute ceuvre ; Eugen Fink le disait naguère de Husserl : les concepts avec lesquels une théorie opère ne sont pas tous objectivés dans le champ que la théorie thématise. Ainsi une philosophie nouvelle s’exprime-t-elle pour une part dans le lan- gage d’une philosophie antérieure ; c’est la source de malentendus sans doute inévitables. Dans le cas de Freud le décalage est manifeste sa découverte se tient aux plans des effets de sens, mais il continue de l’exposer dans le langage et dans la concep- tualité de l’énergétisme de ses maîtres de Vienne et de Berlin. On pourrait objecter que cette discordance appelle, non une reprise philosophique, mais une clarification de la grammaire de notre langue, comme diraient les Anglais, une reconnaissance des règles de ce jeu de langage. Mais cette anomalie du discours freudien requiert un traitement plus radical ; il ne s’agit pas seulement d’un décalage entre la découverte et le vocabulaire disponibles ; cette anomalie du discours freudien tient à la nature même des choses s’il est vrai que la psychanalyse se tient à la flexion du désir et de la culture, on peut s’attendre à ce qu’elle opère avec des notions appartenant à deux plans différents de cohérence, à deux univers du discours : celui de la force et celui du sens. Lan- gage de la force : ainsi tout le vocabulaire désignant la dynamique des conflits, dont le terme de refoulement est le plus connu et le mieux étudié dans ses mécanismes ; mais aussi tout le vocabu- laire économique investissement, désinvestissement, surinves- tissement, etc.
Langage du sens : ainsi tout le vocabulaire concernant l’absurdité ou la signifiance des symptômes, les pensées du rêve, leur surdétermination, les jeux de mots qui s’y rencontrent ; ce sont ces relations de sens à sens que l’on désimplique dans l’interprétation entre sens apparent et sens caché il y a le rapport d’un texte inintelligible à un texte intelligible. Ces relations de sens se trouvent ainsi enchevêtrées dans des rapports de force : tout le travail du rêve » s’énonce dans ce discours mixte : les rapports de force s’annoncent et se dissimulent dans des rap- ports de sens, en même temps que les rapports de sens expriment et représentent les rapports de force. Ce discours mixte n’est pas à mon avis un discours équivoque, je veux dire par défaut de clarification ; ce n’est pas une « category mistake » ; ce discours serre de près la réalité même que la lecture de Freud a révélée et que nous avons appelée la sémantique du désir. Tous les philosophes qui ont réfléchi sur les rapports du désir et du sens ont rencontré ce problème, depuis Platon, qui double la hiérarchie des idées par une hiérarchie de l’amour, en passant par Spinoza, qui lie aux degrés d’affirmation et d’action du conatus les degrés de clarté de l’idée ; chez Leibniz aussi, les degrés d’appétition de la monade et ceux de sa perception sont corrélatifs : « L’action du principe interne qui fait le changement ou le passage d’une perception à une autre peut être appelée Appétition »... (Monadologie, § 15). Freud peut donc être replacé sur une trajectoire connue. Mais, du même coup, une interprétation s’impose la lecture nous mène à un point critique, celui « où l’on comprend que l’énergétique passe par une herméneutique et que l’herméneutique découvre une énergétique. Ce point, c’est celui où la position du désir s’annonce dans et par un procès de symbolisation » (De l’interprétation, p. 75).
C’est d’ailleurs ce qui distingue le concept psychologique de pulsion du concept psycho-physiologique d’instinct la pulsion n’est accessible que dans ses rejetons psychiques, dans ses effets de sens, plus précisément dans les distorsions du sens ; et c’est parce que la pulsion advient au langage dans son représentant psychique qu’il est possible d’interpréter le désir, bien que celui-ci, en tant que tel, reste indicible. Mais, si ce discours mixte empêche la psychanalyse de basculer du côté des sciences de la nature, il l’empêche autant de verser du côté de la sémiologie : les lois du sens, en psychanalyse, ne peuvent se réduire à celles de la linguis- tique issue de Ferdinand de Saussure, de Hjelmslev ou de Jakob- son ; l’ambiguïté de la relation que le désir soutient avec le lan- gage est irréductible ; si bien que, comme Émile Benveniste l’a parfaitement exprimé, le symbolisme de l’inconscient n’est pas un phénomène linguistique stricto sensu : il est commun à plu- sieurs cultures sans acception de langue, il présente des phénomènes, tels que déplacement et condensation, qui opèrent au niveau de l’image et non de l’articulation phonématique ou sémantique ; dans la terminologie de Benveniste, les mécanismes du rêve apparaîtront tour à tour comme infra ou supra-linguistiques ; nous dirons, quant à nous, qu’ils manifestent la confu- sion de l’infra et du supra-linguistique ; ils sont d’ordre infra- linguistique, en ce sens qu’ils marquent la distorsion de la fonction distinctive de la langue ; ils sont d’ordre supra-linguistique, si l’on considère que le rêve, selon une remarque de Freud lui- même, trouve sa véritable parenté dans les grandes unités du discours, tel que proverbes, dictons, folklore, mythes ; de ce point de vue, c’est plutôt au niveau de la rhétorique, avec ses métaphores, ses métonymies, ses synecdoques, ses euphémismes, ses allusions, ses anti-phrases, ses litotes qu’il faut instituer la compa- raison. Or la rhétorique concerne non des phénomènes de langue, mais des procédés de la subjectivité manifestés dans le discours (De l’Interprétation, p. 388). Aussi bien, Freud a-t-il toujours employé le mot Vorstellung - représentation pour désigner l’effet de sens où la pulsion se délègue ; pour lui ce sont les Ding- vorstellungen les « représentations de chose » qui servent de modèles aux Wortvorstellungen, aux « représentations de mot » ; ce sont les mots qui sont traités comme des choses et non l’inverse. J’ai donné dans la note 69 de la page 387 de mon livre des textes. décisifs de Freud à cet égard.
Le représentant de pulsion est ainsi au centre du problème : il n’est ni biologique, ni sémiotique ; délégué par la pulsion et promis au langage, il ne révèle la pulsion que dans ses rejetons et n’accède au langage que par les combinaisons retorses des « investissements de choses », en deçà même des représentations verbales ; il faut donc invoquer un type irréductible de rapports entre signifiants et signifiés ; ces signes, ces effets de sens, ont vocation de langage, mais ne sont pas, dans leur texture spécifique, de l’ordre du langage ; c’est ce que Freud marque par le mot Vorstellung, représentation ; et c’est ce qui tient l’ordre du fantasme distinct de la parole ; Leibniz disait déjà dans le texte que j’ai tout à l’heure lu, mais tronqué : « L’action du principe interne qui fait le changement ou le passage d’une perception à une autre peut être appelée Appétition ; il est vrai que l’appétit ne saurait toujours parvenir entièrement à toute la perception. où il tend, mais il en obtient toujours quelque chose, et parvient à des perceptions nouvelles » (Monadologie, § 15).
Eh bien, nous voilà, avec la transposition leibnizienne du problème freudien de la libido et du symbole, au seuil du problème philosophique.
Je ne dis point qu’une seule philosophie soit capable de fournir la structure d’accueil dans laquelle le rapport de la force et du sens puisse être explicité ; je crois qu’on peut dire la lecture de Freud ; on peut seulement dire une interprétation philosophique de Freud. Celle que je propose se rattache à la philosophie réflexive ; elle s’apparente à la philosophie de Jean Nabert, à qui je dédiais jadis ma Symbolique du Mal ; c’est chez Nabert que j’ai rencontré la formulation la plus serrée du rapport entre le désir d’être et les signes dans lesquels le désir s’exprime, se projette et s’explicite ; avec Nabert, je tiens ferme que comprendre est inséparable de se comprendre, que l’univers symbolique est le milieu de l’auto-explicitation ; ce qui veut dire, d’une part : il n’y a plus de problème de sens, si les signes ne sont pas le moyen, le milieu, le médium, grâce à quoi un existant humain cherche à se situer, à se projeter, à se comprendre ; d’autre part, en sens inverse il n’y a pas d’appréhension directe de soi par soi, pas d’aperception intérieure, d’appropriation de mon désir d’exister sur la voie courte de la conscience, mais seulement par la voie. longue de l’interprétation des signes. Bref, mon hypothèse de travail philosophique, c’est la réflexion concrète, c’est-à-dire le cogito médiatisé par tout l’univers des signes.
Cette hypothèse de travail, je ne le dissimule pas, ne procède pas de la lecture de Freud ; la lecture de Freud la rencontre seulement à titre problématique ; elle la rencontre exactement en ce point où Freud c’est aussi la question du sujet. Comment, en effet, énoncer la séquence Ics, Pcs, Cs, et la séquence moi, ça, sur-moi, sans poser la question du sujet ? Et comment poser la question du désir et du sens, sans demander en même temps : désir de qui ? Sens pour qui ? Mais si la question du sujet est impliquée problématiquement par la psychanalyse, elle n’est pas posée thématiquement encore moins le sujet est-il posé apodictiquement. Or, cet acte par lequel le sujet se pose, ne peut être engendré que de lui-même ; c’est le jugement thétique de Fichte ; dans ce jugement, l’existence est posée comme pensée et la pensée comme existence ; je pense, je suis. Par rapport à cette position, à cette proposition apodictique, tous les « lieux » de la première topique et les « rôles de la seconde séquence freudienne sont des objectivations. Toute la question sera précisément de justifier, de légitimer ces objectivations, comme le chemin obligé vers un cogito. moins abstrait, comme la voie nécessaire de la réflexion concrète. Je tiens donc à souligner qu’il y a un écart entre l’implication problématique de la question du sujet dans la psychanalyse et la position apodictique du sujet dans la philosophie réflexive. C’est cet écart qui fait la distance entre la lecture de Freud et une interprétation philosophique de Freud.
Cet écart, il était nécessaire de le reconnaître clairement, afin de dissiper deux espèces de malentendus qui proviennent les uns et les autres d’une confusion entre lecture et interprétation philosophique.
On ne peut me reprocher de mêler la philosophie réflexive à Freud, puisque je développe la lecture de Freud sans jamais produire le cogito ; la lecture de Freud repose sur un hypothéton, eût dit Platon : cet hypothéton, nous l’avons nommé relation du désir et du sens, sémantique du désir ; pour les psychanalystes, c’est un ti ikanon, un « quelque chose de suffisant », entendons suffisant pour l’intelligence de tout ce qui se passe en ce champ d’expérience et de théorie. La philosophie, en constituant la question du sujet à partir de la position, je pense, je suis, demande la condition de la condition et se dirige vers l’anhypothéton de cet hypothéton. Il ne faut donc pas mêler les objections qu’on peut faire à la lecture de Freud et celles que l’on peut faire à mon interprétation philosophique.
Un second malentendu se produit si l’on saute par-dessus ce moment philosophique, si l’on omet l’acte philosophique initial, pour se porter directement aux conséquences les plus lointaines de ce choix philosophique ; c’est ce qui arrive si l’on s’empare des considérations terminales sur la foi et la religion et qu’on les met en court-circuit avec la critique freudienne de la religion. On ne peut procéder ainsi : il y a une progression obligée dans la suite des pas que je pose : position du sujet, reprise de la psychanalyse comme archéologie du sujet, mise en position dialectique d’une archéologie et d’une téléologie, irruption verticale du Tout-Autre, comme l’alpha et l’oméga dans la double question de l’archéologie et de la téléologie. On peut certes séparer ces thèses, qui ont en effet paru dans un autre ordre et à une autre place dans d’autres philosophies. Mais la philosophie n’est pas un puzzle d’idées, un ramassis de thèmes épars, qu’on pourrait mettre dans n’importe quel ordre ; la manière dont la philosophie procède et enchaîne est seule pertinente ; son architecture commande sa thématique ; c’est pourquoi mes « idées » sur la religion et la foi importent moins, philosophiquement, que la manière dont elles s’articulent sur la dialectique de l’archéologie et de la téléologie ; et cette dialectique, à son tour, ne vaut qu’autant qu’elle articule à son tour intérieurement la réflexion concrète ; et cette réflexion concrète, enfin, n’a de sens qu’autant qu’elle réussit à reprendre la question freudienne de l’inconscient, du ça, de la pulsion et du sens dans la promotion du sujet de la réflexion.
C’est donc là qu’il faut se tenir, parce que c’est le tenon qui fait tout tenir : c’est là que cette interprétation elle-même tient ou tombe.
Je voudrais maintenant m’expliquer sur cette reprise réflexive des concepts freudiens.
:
Ma question est celle-ci qu’arrive-t-il à une philosophie de la réflexion quand elle se laisse instruire par Freud ?
Cette question a un endroit et un envers. A l’endroit, elle signifie ceci : comment le discours mixte de Freud sur le désir et le sens s’inscrit-il dans une philosophie réflexive ? Mais le revers, le voici qu’advient-il au sujet de la réflexion quand sont prises au sérieux les ruses de la conscience, quand la conscience est découverte comme conscience fausse qui dit autre chose qu’elle dit et croit dire ? Cet endroit et cet envers sont inséparables comme ceux d’une pièce de monnaie ou d’un tissu. Car, dans le même temps que je dis le lieu philosophique du discours analytique est défini par le concept d’archéologie du sujet, je dis aussi après Freud, il n’est plus possible d’établir la philosophie du sujet comme philosophie de la conscience ; réflexion et conscience ne coïncident plus ; il faut perdre la conscience pour trouver le sujet. Le sujet n’est pas celui qu’on croit ; l’apodicticité du cogito ne peut être attestée, sans que soit en même temps. reconnue l’inadéquation de la conscience ; comme le sens de la chose, quoique pour d’autres raisons, le sens de ma propre existence est lui aussi présumé ou présomptif. Il est alors possible de répéter le freudisme, d’en faire une répétition réflexive, qui soit en même temps une aventure de la réflexion. J’ai appelé dessaisissement ou déprise ce mouvement auquel me contraint la systématique freudienne ; c’est la nécessité de ce dessaisissement qui justifie le naturalisme freudien. J’adopte ce qu’il y a de plus choquant, de plus philosophiquement insupportable dans le réalisme freudien des « localités » psychiques ; j’adopte son anti- phénoménologie décidée, j’adopte son énergétique et son écono- mique, comme les instruments d’un procès intenté contre le cogito illusoire qui occupe d’abord la place de l’acte fondateur du je pense, je suis. Bref, j’use de la psychanalyse comme Descartes. usait des arguments sceptiques contre le dogmatisme de la chose ; mais, cette fois, c’est contre le cogito lui-même, ou plutôt, c’est au sein du cogito que la psychanalyse vient scinder l’apodicticité du Je des illusions de la conscience et des prétentions du moi. Dans un essai de 1917, Freud parle de la psychanalyse comme d’une blessure et d’une humiliation du narcissisme, comme le furent, dit-il, à leur façon, les découvertes de Copernic et de Darwin, qui ont décentré le monde et la vie par rapport à la prétention de la conscience. La psychanalyse décentre de la même manière la constitution du monde fantasmatique par rapport à la conscience. Au terme de ce dessaisissement, la conscience a changé de signe philosophique : elle n’est plus une donnée ; il n’y a plus de « données immédiates de la conscience »> ; elle est une tâche, la tâche de devenir-conscience. Là où il y avait Bewusstsein, être- conscient, il y a Bewusstwerden, devenir-conscient. Ainsi, le côté énergétique et économique du freudisme a été deux fois affirmé : une fois dans la lecture même de Freud, contre toute réduction sémiologique, afin de sauver la spécificité même de la psychanalyse et de la maintenir à la flexion de la force et du sens ; une deuxième fois, dans l’interprétation philosophique, afin de garantir l’authenticité de l’ascèse et du dépouillement par lesquels la réflexion doit passer pour rester authentique. En même temps, l’énigme du discours freudien - énigme pour une pure considération épistémologique - devient paradoxe de la réflexion : l’énigme du discours freudien, on s’en souvient, c’était l’entrelacs du langage énergétique et du langage herméneutique ; transcrit en style réflexif, cela donne réalité du ça, idéalité du sens ; réalité du ça dans la déprise, idéalité du sens dans la reprise ; réalité du ça, par régression des effets de sens, paraissant au niveau conscient jusqu’à la pulsion, au niveau inconscient ; idéalité du sens, dans le mouvement d’interprétation qui amorce le devenir-conscient. C’est ainsi que la lecture de Freud devient elle- même une aventure de la réflexion. Ce qui émerge de cette réflexion, c’est un cogito blessé ; un cogito qui se pose, mais ne se possède pas ; un cogito qui ne comprend sa vérité originaire que dans et par l’aveu de l’inadéquation, de l’illusion, du mensonge de la conscience actuelle.
La seconde étape de l’interprétation philosophique que je propose est marquée par la dialectique de l’archéologie et de la téléologie. Cette avance de la réflexion représente bien quelque chose de nouveau, à savoir une polarité de l’arché et du télos dans la réflexion. J’y viens par une reprise des aspects temporels du freudisme. Ces aspects temporels sont précisément liés au réalisme freudien de l’inconscient et du ça ; mieux : ils tiennent à l’économique freudienne plus encore qu’à sa topique ; il y a, en effet, dans la position du désir une antériorité à la fois phylo- génétique, onto-génétique, historique et symbolique ; le désir est à tous égards avant ; il est prévenant. Le thème de l’antérieur est la hantise du freudisme ; et je le défendrais contre tous les culturalismes, qui ont tenté de lui rogner les dents et les griffes, en réduisant à des malfaçons de notre rapport actuel à l’envi- ronnement le côté sauvage de notre existence pulsionnelle, ce désir antérieur qui nous tire en arrière, et qui insinue toutes les arriérations de l’affectivité, au plan des rapports de famille, au plan fantasmatique de l’oeuvre d’art, au plan éthique de la culpabilité, au plan religieux de la crainte de punition et du désir infantile de consolation. Freud est fort quand il parle de l’inconscient comme zeitlos, comme « intempestif », c’est-à-dire comme rebelle à la temporalisation liée au devenir-conscient. C’est cela que j’appelle archéologie archéologie restreinte de la pulsion et du narcissisme ; archéologie généralisée du sur-moi et des idoles ; archéologie hyperbolique de la guerre des géants, Eros et Thanatos. Mais il faut bien voir que le concept d’archéologie est lui-même un concept réflexif ; l’archéologie est archéologie. du sujet c’est ce que Merleau-Ponty avait bien vu et bien dit. dans son introduction au livre du Docteur Hesnard : l’OEuvre de Freud.
C’est parce que le concept d’archéologie est un concept philosophique -un concept de philosophie réflexive que l’articulation en archéologie et téléologie est aussi une articulation de la réflexion, dans la réflexion. C’est la pensée réflexive qui dit : seul a une arché un sujet qui a un télos car l’appropriation d’un sens constitué en arrière de moi suppose le mouvement d’un sujet tiré en avant de lui-même par une suite de figures dont chacune trouve son sens dans les suivantes.
Cette nouvelle avancée de la pensée fait assurément problème ; c’est pourquoi je propose de la commenter par quelques remarques. de tour plus problématique. D’abord, il est bien vrai que la psychanalyse est une analyse : c’est-à-dire, selon l’expression rigoureuse de Freud, une décomposition régressive ; il n’y a pas, selon lui, de psychosynthèse ; du moins la psychanalyse comme telle n’a pas à proposer de synthèse. C’est pourquoi l’idée d’une téléologie du sujet n’est pas une idée freudienne, c’est une notion philosophique que le lecteur de Freud forme à ses risques et périls. Toutefois, cette notion de téléologie du sujet n’est pas sans appui chez Freud lui-même ; Freud en a rencontré l’équivalent, ou l’amorce, dans un certain nombre d’expériences et de concepts. théoriques que la pratique de l’analyse a mis sur son chemin ; mais ces expériences et ces concepts ne trouvent pas leur lieu dans le schéma freudien de l’appareil psychique ; c’est pourquoi ils restent en l’air, comme j’ai essayé de le montrer pour les concepts d’identification et de sublimation, dont Freud dit expres- sément qu’il n’en a pas trouvé d’explication qui le satisfasse. Deuxième remarque j’ai rattaché l’idée de téléologie du sujet à la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel ; cet exemple n’est pas contraignant ; il est seulement éclairant ; il est éclairant en ceci que la téléologie ou, pour citer exactement Jean Hyppolite, la < dialectique téléologique » y est la seule loi de construction des figures ; il est éclairant encore en ceci que la dialectique des figures donne son sens philosophique à toute maturation psychologique, à toute croissance de l’homme en dehors de son enfance ; la psychologie demande : comment l’homme sort-il de l’enfant ? Eh bien, il en sort en devenant capable d’un certain parcours signifiant, qui a été illustré par un certain nombre de grandeurs culturelles, lesquelles tirent elles-mêmes leur sens de leur arrangement prospectif. L’exemple de Hegel est éclairant encore en ce sens qu’il nous permet de dissocier téléologie et finalité, du moins au sens des causes finales critiquées par Spinoza et par Bergson. Téléologie n’est pas finalité : les figures, dans la dialectique téléologique, ne sont pas des causes finales, mais des significations tirant leur sens du mouvement de totalisation qui les entraîne et les fait se dépasser en avant d’elles. L’exemple hégélien est enfin éclairant en ce qu’il permet de donner un contenu à l’idée vide de projet existentiel, qui resterait toujours à lui-même son propre projet et ne se déterminerait que dans l’arbitraire, le désespoir, ou tout simplement le conformisme le plus plat. Mais, si l’exemple hégélien est exemplaire, il n’est pas contraignant ; j’ai essayé pour ma part d’esquisser un enchaînement des sphères de culture, de l’avoir économique au pouvoir politique et au valoir personnel, dont le contenu est assez différent, si l’orientation générale est la même. En tout ceci, ce qui est en question, c’est bien le passage non à la conscience, mais de la conscience à la conscience de soi. L’enjeu est le Soi ou Esprit.
Il n’est pas sans importance de découvrir que la prétention de la conscience n’est pas moins humiliée dans la dialectique ascendante des figures de l’esprit que dans la décomposition régressive des fantasmes du désir. C’est dans ce double dessaisissement de nous-mêmes, dans ce double décentrement du sens, que consiste la réflexion concrète. Mais c’est encore la réflexion qui fait tenir ensemble régression et progression ; c’est dans la réflexion que s’opère la relation entre ce que Freud appelle inconscient et Hegel esprit, entre le primordial et le terminal, entre le destin et l’histoire.
Vous me permettez de m’arrêter ici et de ne pas pénétrer dans le dernier cérole de la réflexion concrète ; je dis dans l’argument : « Cette dialectique est le sol philosophique sur lequel peut être établie la complémentarité des herméneutiques rivales de l’art, de la morale et de la religion ». C’est à dessein que je n’ai pas consacré un paragraphe particulier à cette question des herméneutiques rivales de l’art, de la morale et de la religion. La solution. dialectique que je tente d’appliquer à ce problème n’a aucune espèce d’autonomie par rapport à ce que j’ai appelé la dialectique de la progression et de la régression, de la téléologie et de l’archéologie. Il s’agit d’appliquer une méthode philosophique déterminée à un problème déterminé, celui de la constitution du symbole, que j’ai décrit comme expression à double sens. Je l’ai appliqué aux symboles de l’art, de l’éthique et de la religion ; mais la raison de cette méthode n’est ni dans les domaines considérés, ni dans les objets qui leur sont propres ; elle réside dans la sur- détermination du symbole, laquelle ne se comprend pas en dehors de la dialectique de réflexion que je propose ; c’est pourquoi toute discussion qui traite comme un thème isolé ma double interprétation des symboles religieux la ramène nécessairement à une philosophie du compromis d’où l’aiguillon de la lutte a été retiré. Dans cette terrible bataille pour le sens, rien ni personne ne sort indemne la « timide » espérance doit traverser le désert de la conduite du deuil. C’est pourquoi je m’arrête sur le seuil de la lutte des interprétations ; et je m’arrête en me donnant à moi- même cet avertissement : hors de la dialectique de l’archéologie et de la téléologie, ces interprétations s’affrontent sans arbitrage possible ou se juxtaposent dans des éclectismes paresseux qui sont la caricature de la pensée.
M. Gouhier. Cette très profonde communication appelle beaucoup mieux que ces compliments qu’on improvise avec des formules usées. Le meilleur commentaire de nos applaudissements sera de poser à Paul Ricoeur des questions très précises. sur le sujet qu’il a lui-même si bien délimité, en donnant à notre. discussion une devise que je trouve dans ce qui vient de nous être dit : « Il faut être bien au clair sur ce qu’on fait ici. »
