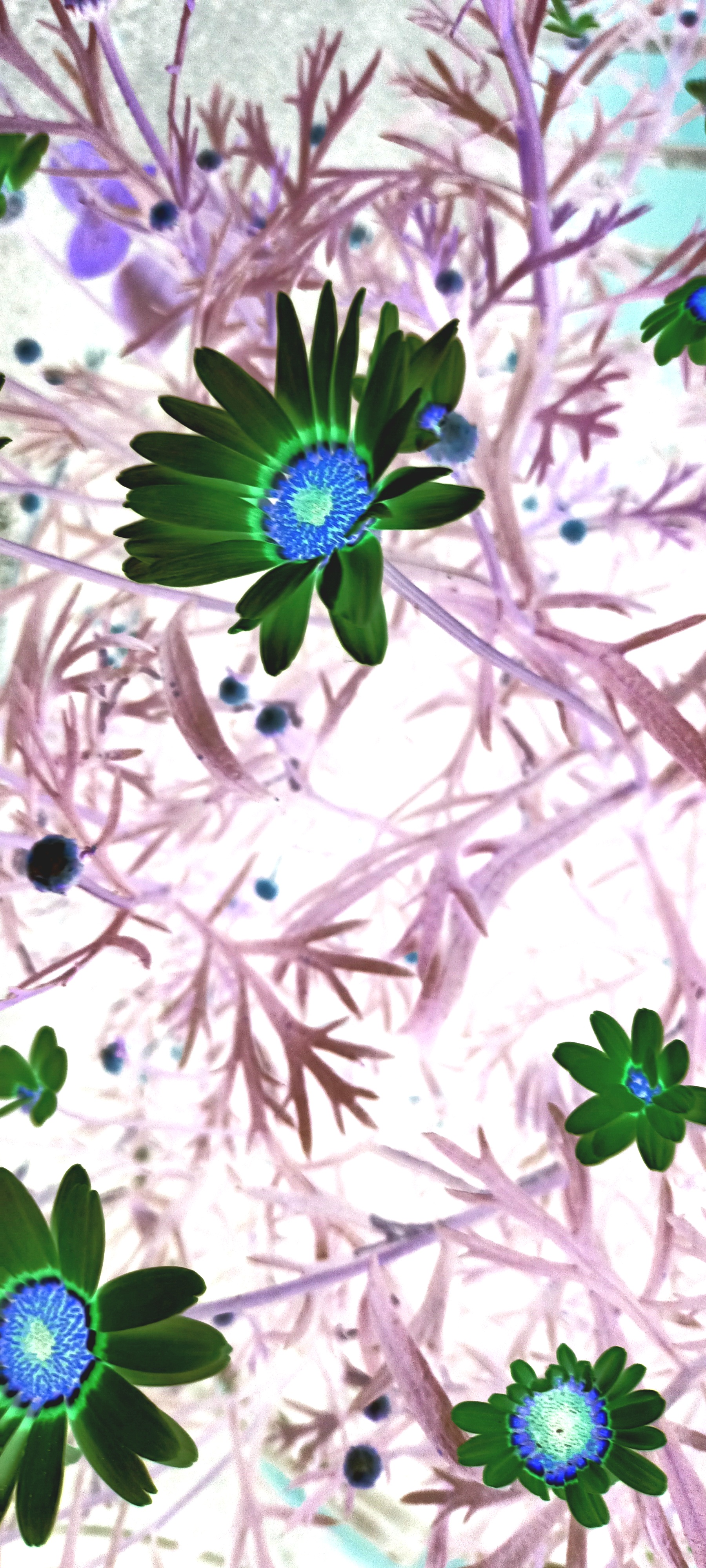
– Dans La Grande Illusion de Jean Renoir (1937), la posture de l’aristocrate Boëldieu au moment de sa mort peut rappeler celle du comte Orlock, tué par un rai de lumière à la fin du Nosferatu de F. W. Murnau.
À partir de cette analogie, ce montage revient sur les rapports de classes dans La Grande Illusion.
Auteur : Jean-François Buiré. Ciclic, 2013.
Qu’elle était verte ma vallée John Ford1941
Quelques repères :
– > Le mélodrame retravaillé comme la construction d’un mythe. Le grand plan pour évoquer les affects d’individus particuliers ou le détail (l’envol du voile). Transformation du grand plan classique.
– > la révolte et la fin d’une époque symbolisée par la mort du père et son remplacement progressif par le personnage de la mère.
– > Naissance du capitalisme vue sous l’angle mythologique. Age d’or et âge d’airain.
– > le regard de l’enfant. Ford inclut le récit dans le récit d’un enfant. Il invente une nostalgie pour un passé qui n’ a jamais existé. C’est le souvenir construit par un enfant, pas un souvenir objectif.
– > le sacrifice ne cesse de se répéter. (le pasteur, l’enfant)
– > la clairvoyance ne sert à rien, d’où les sacrifices inutiles. Le conte de fée dissimule un cauchemar.

