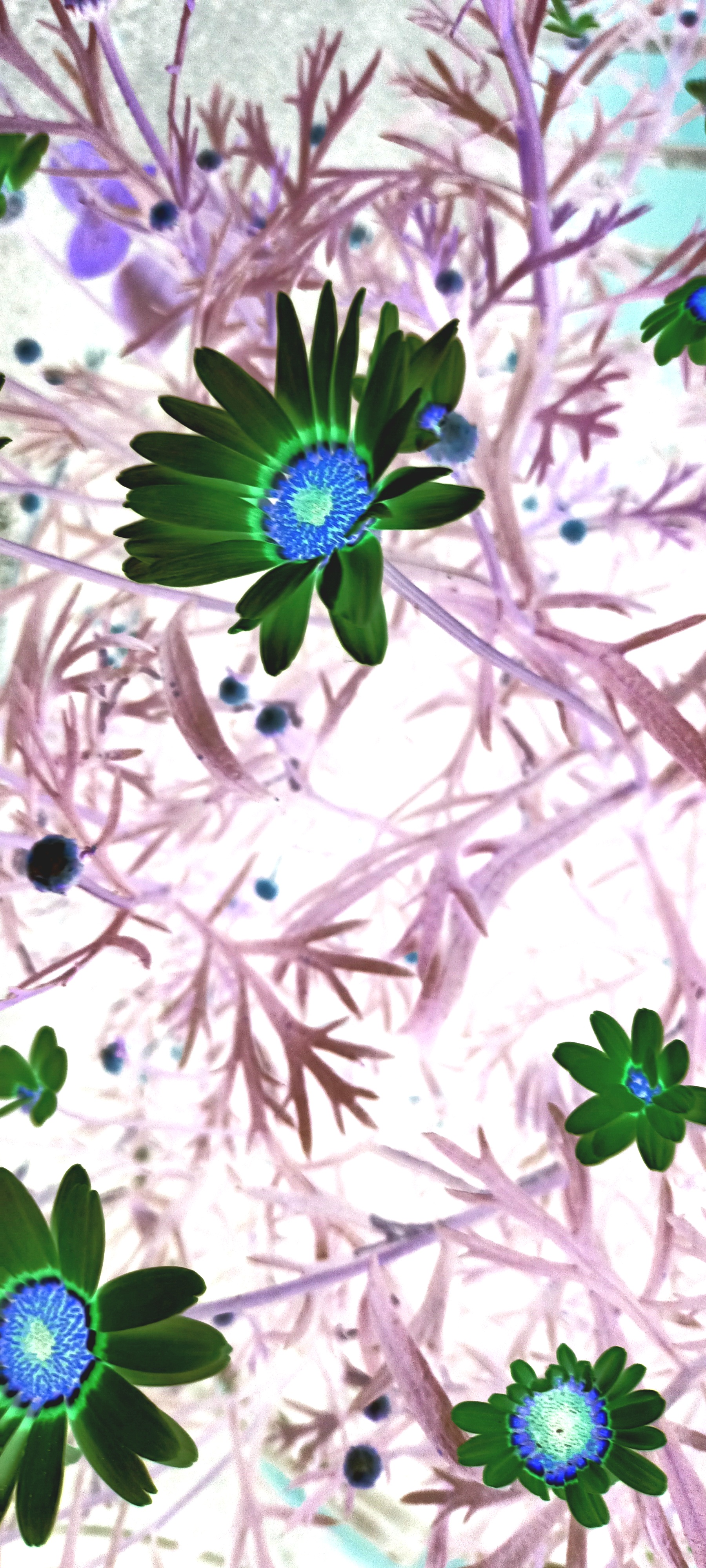
*L’homme invisible

- Analyse d’une séquence
- Dossier sur le film : https://transmettrelecinema.com/film/homme-invisible-l/#pistes-de-travail
- analyse du ciné-club de Caen
- Puissance de la voix https://transmettrelecinema.com/wp-content/uploads/2013/07/136_1.mp4
- Comme on l’a vu la réussite du film tient en grande partie dans la fusion du fantastique et du comique qui dédouble la lecture. A cet égard l’homme » aux bandelettes » avec sa tête ronde et lisse dont n’émerge qu’une arête de nez comme un bec surmonté des deux globes noirs des lunettes, fait plutôt figure de » drôle d’oiseau » que de monstre. De même la voix tranchante et caverneuse de Claude Rains à l’élocution presque déclamatoire (un rien shakespearienne) et grandiloquente peut inspirer aussi bien le rire que l’effroi. On est bien dans la tradition britannique de l’étrange où le non sensique, la dérision et le grotesque le disputent au terrifique. Enfin sont remarquables les effets spéciaux où la présence de l’invisible ne peut se lire qu’en creux : voix, vêtements, objets flottant dans l’espace. Tout semble relever d’une prestidigitation où s’origine le cinéma de fiction : l’art du grand Méliès inventeur des premiers trucages cinématographiques grâce auxquels gambadaient déjà des corps sans tête…
L’étrange homme du parlant
La parole, on le sait bien, est la ressource et
même étymologiquement l’origine du diable.
Maurice Blanchot
L’Homme invisible (1933) de James Whale, produit par les studios Universal, appartient à cette vague du cinéma fantastique apparue au début des années trente, appelée « The Golden Age of Horror ». Il est d’usage d’associer cette épidémie de films destinés à faire peur avec la crise économique de 1929, son vent de panique initial et l’onde de choc qui s’ensuit, génératrice d’inquiétude dans les diverses couches de la population. La scène où l’homme invisible entre dans une banque, subtilise de l’argent qu’il distribue aux passants comme on jette du grain à la volaille (« Money, money, money ! »), y fait référence, dessinant prémonitoirement, de façon sauvage et subversive, l’image d’une nouvelle donne (« New deal ») prisonnière d’une aliénation fondamentale. Si la scène figure dans le roman de Wells paru en 1897, elle prend cependant, d’avoir été conservée, une toute autre dimension, même si l’homme invisible prend moins aux riches pour donner aux pauvres qu’il ne dénonce la dépendance à l’argent, ce veau d’or des temps modernes.
La chasse à l’homme, qu’elle se déroule dans des conditions anormales (Les Chasses du Comte Zaroff, 1932) ou qu’elle vise à neutraliser l’autre dans ses excès (Dr. Jekyll et Mr. Hyde, 1932), en raison de son anormalité physique et des dangers qu’elle représente pour la communauté des vivants (Frankenstein, 1931), sans oublier l’impossible domestication de la supposée sauvagerie naturelle de l’autre issu du continent africain (King Kong, 1933), est une règle du fantastique des années trente. L’imposant déploiement des forces de police dans L’Homme invisible, l’appel à la population civile pour organiser la battue, témoignent de cette paranoïa sécuritaire (le péril fasciste, le combat contre un assassin qui fait régner la terreur) qui sévit régulièrement dans le cinéma américain, pour différentes causes (le maccarthysme et la chasse aux sorcières, l’ennemi parmi nous ou venu d’ailleurs, à exterminer), et dont le cinéma fantastique et de science-fiction, à travers les âges, s’est fait l’écho. Pourtant, plus qu’au cinéma américain de genre, c’est l’influence de Fritz Lang qui se fait sentir en voyant L’Homme invisible. De M, autre récit d’une chasse à l’homme, on retrouve le rythme du découpage avec séquences courtes, montage alterné et enchaînement de plans autonomes descriptifs pour restituer le déploiement d’une action dans son ensemble. Mais c’est surtout à Mabuse qu’on pense, tant le héros conçu par Whale fait figure de version américaine du personnage conçu par Lang : même folie du pouvoir, même volonté de destruction pour voir le monde ramper à ses pieds. L’utilisation de la drogue pour devenir invisible, aux effets secondaires nocifs, puisqu’elle rend Griffin dans un premier temps irascible avant de l’entraîner dans la folie criminelle (délire des grandeurs, croyance en la supériorité inégalable de son intelligence), n’existe pas dans le roman de Wells, soucieux de plonger un être normal dans une situation provisoirement anormale. Le recours à la monocaïne apparaît comme un alibi, une caution médicale, voire une faiblesse de scénario de crainte d’aborder le vrai sujet en face. Chez Lang, Mabuse n’a pas besoin d’expédients de la sorte car c’est de son invisibilité qu’il tire son pouvoir, cette folie raisonnée et planifiée qui l’incite à faire dérailler le monde pour mieux l’asservir. Dans Le Testament du docteur Mabuse (1), personne ne connaît l’identité de celui qui répond au nom de Mabuse. Pour tous, aussi bien ses poursuivants que ses acolytes, il demeure l’homme invisible, statut qui lui permet d’asseoir son pouvoir. Il est comme Jack Griffin une voix sans corps. La silhouette de Mabuse qui se découpe en contre-jour est factice. D’où vient cette voix qui parle derrière le rideau ? Quel est son lieu, son origine ? Le héros conçu par Whale reformule cette interrogation. L’homme invisible signale sa présence par la voix et la découverte de son existence tangible sur le plan sonore s’épaissit d’un mystère : le lieu où elle prend sa source pour parvenir aux oreilles des auditeurs puisque le corps, considéré comme le théâtre originaire de la voix, demeure invisible. Plus que la possibilité du corps humain à devenir invisible, ce sont les limites de la visibilité du lieu où la voix humaine prend réellement sa source que le film de Whale interroge.
Lorsque Wells reprochait à l’adaptation d’avoir ajouté l’idée de la monocaïne, dénaturant la destinée tragique de son personnage, humain et pathétique, angoissé par la perspective d’un impossible retour à la normale (2), Whale avait beau jeu de lui répondre : « Si un homme vous disait vouloir se rendre invisible, ne penseriez-vous pas qu’il est déjà fou ? » Être invisible est un pouvoir que diverses croyances attribuent généralement au Dieu omniprésent qui voit et entend tout, lisant parfois dans les pensées (3). En faisant du désir scientifique d’invisibilité le point originaire de la folie du personnage – preuve supplémentaire de l’inutilité scénaristique de sa justification par la monocaïne, simple artefact du délire du personnage – le film de Whale redonne au roman de Wells une dimension essentielle qui lui faisait défaut : la figure du savant qui, au lieu de vouloir égaler Dieu en créant un homme à son image (voir le Frankenstein de James Whale) tente de l’égaler en lui ressemblant par ce qui le caractérise, à savoir l’invisibilité et, corollaire de son statut, l’existence par la voix, le Verbe incarné. C’est en rivalisant avec la substance invisible de Dieu que l’homme devient le Diable, assurant par son pouvoir le triomphe du mal.

Pas vu, pas pris
Si la folie de l’homme invisible devient vite odieuse, elle ménage en lui des effets contradictoires car sa transformation fait régresser le personnage. Il se comporte souvent en gamin facétieux qui se plaît à jouer des mauvais tours (le chapeau du vieillard qui s’envole, l’encrier jeté à la figure du policier sceptique). La méprise de Jenny l’aubergiste lorsqu’elle gronde les enfants du village, les accusant à tort de jouer avec la porte de l’auberge alors qu’il s’agit de l’homme invisible revenu chercher ses affaires, le formule explicitement. Cette survivance du burlesque et de la farce appartiennent à l’imaginaire du conte (les innombrables ruses du renard) et du guignol (le gendarme et le voleur).
En jouant au chat et à la souris avec les forces de l’ordre, l’homme invisible montre leur incompétence et les ridiculise (l’inoffensif chaton pulvérisé, la capture de la chemise, le policier qui voltige et en perd son pantalon). Si le comportement du personnage inspire de la terreur, les policiers font rire. Lorsque la marche du pantalon dans la nuit effraie la femme, l’enfant ne s’identifie pas à sa peur. Il est avec l’homme invisible, sautillant et chantonnant. La nature maladroite de certains effets spéciaux mécaniques – la maquette du train qui tombe dans le vide, accompagnée des ricanements de l’homme invisible – renforce involontairement cette dimension enfantine dans son entreprise de destruction systématique, à la façon dont un enfant s’amuse à faire dérailler un train électrique, pour le plaisir, juste pour voir. Avant que l’éducation s’en mêle (autorité parentale et autres figures de la loi) et interdise à l’enfant de se livrer à de tels jeux destructeurs, au nom du respect dû aux objets, jouets compris.
Lorsqu’un enfant commet une bêtise et est pris en flagrant délit, puni en conséquence, il comprend vite deux choses. Soit la réponse de l’autre à son acte le dissuade de recommencer, soit elle l’incite à le reproduire à l’identique en usant d’un subterfuge. C’est le règne du « pas vu pas pris » qui est pour l’enfant une première expérience de la loi, une manière de jouer avec elle tout en désirant se jouer d’elle. Avant d’en découvrir les limites. La dimension hétéroclite du personnage de l’homme invisible, tantôt monstre terrifiant ou grand enfant évoluant dans un monde redevenu totalement ludique, trouve ici sa justification puisque l’invisibilité devient le lieu même où le sujet, en toute impunité, se met hors-la-loi, dans le hors-champ de son domaine d’intervention, le juridique étant déterminé par le visible (preuves tangibles, établissement des faits).
Le corps momifié du muet
Dès le premier plan et l’entrée dans l’auberge, le personnage ressemble à une momie égyptienne en liberté, plus proche du héros de La Momie de Karl Freund (1932) que de l’image attendue d’un homme invisible. Jack Griffin désire devenir invisible et s’isole aussitôt pour revenir à son état normal. Comme le note Jacques Lourcelles, il« se trouve dans la situation d’un Hyde qui ne pourrait jamais redevenir Jekyll (4) ». La plupart des scénarios du fantastique du début des années trente parlent de la mutation du muet au parlant. Ils expriment l’angoisse de la transformation du corps cinématographique lié à ce passage, signe d’une révolution technologique irréversible. Ils sont la chambre d’écho, la caisse de résonance ultra-sensible de ces bouleversements en cours. Tel qu’il apparaît, l’homme invisible est un zombie, un corps du cinéma muet. C’est un revenant, une voix d’outre-tombe, caverneuse, aux accents shakespeariens, qui vient hanter le cinéma parlant. Dans cet autre monde où il passe pour un étranger, rejeté comme tel par la communauté des corps visibles et parlants, la voie du retour à la normale, comme avant, au temps du muet (« It must be a way back » répète à loisir le héros, sûr de lui), est condamnée à l’échec. La fin boucle le parcours de cette figure. Lorsque le héros montre son vrai visage sous ses bandelettes, celui qu’autrefois Flora a tant aimé (le portrait dérobé au spectateur), c’est de la mort qu’il s’agit : une crâne puis un cadavre allongé dans son lit, tel un gisant ornant définitivement la pierre tombale du cinéma muet (5).
De tous les films à la charnière du muet et du parlant, L’Homme invisible est le plus riche et le plus profond. C’est dans le regard qu’il porte sur ce changement de nature technique que le film est à proprement parler fantastique. Dans le cinéma muet, le corps est visible mais la voix inaudible. Dans le parlant traditionnel, le corps gagne sur les deux tableaux : on continue de le voir et on l’entend parler. Dans la version que propose le film, il en va tout autrement. Ce que le corps gagne d’un côté avec la voix, il le perd de l’autre en raison de sa soudaine invisibilité. Soit on voit le corps sans l’entendre (le muet), soit on l’entend sans le voir. Problème de transfert par conséquent, la qualité du report optique s’accompagnant d’une déficience dans l’enregistrement des images. La voix de l’homme invisible émane d’un corps réel qui a le défaut ou l’avantage d’être imperceptible à l’œil. Ce corps vocal présent (le lieu de la voix) et absent, invisible, redouble la condition de la voix radiophonique. Le début du parlant, en plus de s’inspirer du théâtre, a surtout été subjugué par la puissance de la radio (6). En ce sens, L’Homme invisible est le contemporain du dispositif sonore de Mabuse du Testament et il annonce les dispositifs sonores explorés par Orson Welles, aussi bien à la radio (son adaptation de La Guerre des mondes, d’après H. G. Wells) qu’au cinéma.
Lorsque l’homme invisible demande à Kemp de l’accompagner à l’auberge où il a laissé sa documentation scientifique, il le dirige à la façon dont un cinéaste dirigeait un comédien au temps du cinéma muet : en donnant de la voix dans les coulisses de la prise de vues. Il lui fournit l’emplacement où il doit l’attendre (« Guette la fenêtre qui s’ouvrira ») et va même jusqu’à le conseiller sur son jeu : « Fais celui qui attend quelqu’un. » Le pouvoir de l’homme invisible devient alors celui du metteur en scène en retrait qui dirige un acteur, toujours bien en vue.
Griffin, Lion’s Head
Le nom de Griffin évoque celui de griffon, figure mythologique, née du croisement de l’aigle et du lion. De ces deux animaux, l’aigle dominateur qui s’abat sur sa proie et le lion impérial et souverain, l’homme invisible en a le caractère. L’ironie du sort, propre au film (le décor de l’enseigne de l’auberge, lieu non baptisé dans le roman), veut que le héros entre dans un lieu appelé « Lion’s Head » : la tête du lion. Le premier geste volontaire de Griffin pour dévoiler son invisibilité concerne sa tête puisqu’il déroule ses bandages pour montrer qu’il n’en a pas. Il devient alors la « Tête du lion ». Au sens où il commence à perdre la tête, au propre comme au figuré.
L’homme invisible n’est pas un esprit, un fantôme, une présence immatérielle réduite à sa seule voix. Il ne cesse d’avoir un corps, un organisme, sauf qu’il ne fait plus image, pour lui (son stade du miroir, singulier) et pour les autres. Ce qu’il perd en imago, il le compense par le vestigium, mot qui désigne littéralement la trace de pas dans le sable, l’empreinte en creux. Trace de pas dans la neige qui le perdra à la fin, et qui fait écho à la neige en ouverture. De même, sur un autre registre, c’est l’organe sollicité par le cinéma parlant (le souffle qui gonfle la poitrine, le ronflement de l’homme endormi) qui causera sa perte. Le suaire de Véronique constitue le prototype fondateur de toute image en ce qu’il instaure la ressemblance au modèle, la fonde dans son principe, et qu’il est une prise d’empreinte, un transfert de surface à surface. Quand le corps de Jack Griffin cesse d’être visible, il continue de faire image par les traces de sa présence. Dès qu’il s’asseoit dans un fauteuil, s’allonge dans un lit ou que son corps fait une chute mortelle dans la neige, sa présence invisible se fait voir. C’est la technique du moulage, le corps de la sculpture (7). L’empreinte négative qui rejoint le principe de la pellicule impressionnée.
Les secrets du hors-champ

Être présent, tantôt visible et invisible, c’est la destinée ordinaire de tout corps cinématographique. Destinée que L’Homme invisible rend fantastique, tant c’est la capacité du cinéma à faire apparaître et disparaître les corps (l’escamotage par le montage et le hors-champ) qui est la première source d’étonnement. Escamotage qui relève de la performance de cirque, de la prouesse du magicien (le monde singulier des films de Tod Browning) ou des capacités de la technique cinématographique, tôt explorée par Méliès. Ce jeu de l’apparaître et du disparaître est un attribut ordinaire du cinéma que le film de James Whale, via l’histoire de l’homme invisible, contribue à rendre fantastique. Un plan montre deux personnages assis en train de discuter. La caméra isole celui qui parle avant de montrer quelques secondes plus tard celui qui l’écoute. Lorsqu’on voit l’homme seul parler, l’autre est invisible dans le hors-champ mais continue néanmoins d’être présent, d’exister au regard de la fiction. Quand le second l’écoute, la voix de l’autre est off, audible sur un corps provisoirement invisible, avant un retour à la normale (voix in) qui ne posera pas de problèmes. C’est l’expression cinématographique du parlant, sa rhétorique de base, qui constitue le matériau fantastique de L’Homme invisible. Quand Kemp est assis dans un fauteuil et parle à Griffin hors champ, l’autre est doublement invisible, avant qu’un plan, par un indice (la fumée de sa cigarette) signale sa présence. Les moments les plus beaux, de loin les plus forts, sont ceux furtifs où l’homme invisible en mouvement est insituable pour le spectateur. D’une certaine manière, on le perd une seconde fois de vue. On ne sait plus s’il se trouve dans le plan, marchant au côté de Kemp ou l’accompagnant hors champ, dans les marges du cadre, en réserve de la fiction. Quand Griffin demande à Kemp des vêtements, des gants et des bandages pour poursuivre la conversation sur un mode traditionnel, lui permettant de voir celui à qui il parle, un plan montre Kemp gravissant l’escalier. En une fraction de seconde, on suppose que la caméra restitue le point de vue de l’homme invisible, tenant l’autre à l’œil (8), avant de découvrir, au moment où il lui remet les vêtements, que l’homme invisible est dans le plan et qu’il s’agissait par conséquent d’un faux plan subjectif. Le propre de l’homme invisible, tel que James Whale le filme, consiste à brouiller la frontière du champ et du hors-champ au point de la rendre indécidable, son corps ayant le pouvoir de propager l’invisible du hors-champ à l’intérieur du cadre. Il est aussi celui qui perturbe la qualité d’un plan, brouille l’attribution du regard qui le justifie : s’agit-il d’un plan objectif (un nobody’shot) que le metteur en scène offre au seul spectateur ou bien un plan subjectif que le spectateur partage avec l’homme invisible, cet oeil dont le corps se dérobe en permanence à la vue ?

L’invisible présence de la caméra
L’Homme invisible déplie deux niveaux de hors-champ. Le premier concerne la contiguité homogène de l’espace narratif, selon le principe de la partie, présente et visible, et du tout qui l’englobe, omniprésent et provisoirement invisible. Ce qu’André Bazin appelle la continuité vivante du recadrage. Le second, hétérogène, vise un tabou, un interdit du cinéma : la présence de la caméra et, avec elle, le spectateur du film, autre figure d’un corps présent qui demeure invisible, inaccessible aux personnages de la fiction. La caméra, outil nécessaire à la prise de vues, est toujours présente, à proximité des acteurs, parmi eux mais ils doivent faire comme s’ils ne la voyaient pas. Savoir que la caméra existe tout en étant celui qui ne la voit pas est la condition de jeu de l’acteur au cinéma. De ce point de vue, l’homme invisible dans le plan est le double matériel et invisible de la présence de la caméra à l’avant-plan. Comme l’homme invisible, la caméra est une masse encombrante. On peut se heurter à elle et il est impossible matériellement de se substituer à la place qu’elle occupe lors de la prise de vue. Lorsqu’un acteur sort du champ par devant, il passe à côté de la caméra, à droite ou à gauche. Quand il vient sur elle, la masse de son corps obscurcit l’image et on le récupère en contrechamp de dos. Il n’y a que dans les films de Jerry Lewis où l’acteur rate sa sortie, se prend les pieds dans les cables ou les rails de travelling et heurte la caméra, à la façon dont un personnage peut être amené à se cogner dans un plan contre l’homme invisible.
Deux plans du film de James Whale font de la caméra une empreinte négative qui, par sa seule présence invisible, sculpte la matière représentée. Deux plans qui accusent la convention du cinéma et font explicitement sentir que la caméra est un corps massif, qui doit rester invisible (l’impossible way back, l’interdit fondateur) afin de mouler en creux la scénographie du plan.
Flora, la fille du docteur Cranley, se retire dans la pièce qui jouxte le laboratoire de son père [séquence 4]. Lorsque Kemp la rejoint et ouvre la porte qui sépare les deux pièces, un travelling latéral droit accompagne sa traversée. Pour ménager le passage de la caméra d’une pièce à l’autre, la cloison s’arrête au premier plan. La disposition du décor confine au gag. On se demande pourquoi l’acteur prend la peine d’ouvrir la porte alors qu’il aurait très bien pu profiter de l’espace dégagé pour faciliter le déplacement de la caméra d’un lieu à l’autre (9).
La foule danse au son d’une musique [séquence 17]. Lorsqu’elle cède la place à un message radiophonique, la caméra s’immisce à travers la foule (10). On croit à travelling avant subjectif de l’homme invisible qui se fraye un chemin parmi l’assemblée. Mais si tel était le cas, il devrait les bousculer physiquement. Là, ils s’écartent magiquement pour dégager le passage. Scénographie de convention, non justifiée par un mouvement dramaturgique comme l’arrivée d’un personnage par le front de scène, et qui a pour effet de signaler avec insistance la présence de la caméra qui ourle en permanence le champ visuel.
Les origines du cinéma sont peuplées de films où des personnages épient le comportement des gens à travers un trou. Redoublement du dispositif cinématographique qui traduit l’étonnement de l’époque devant ce que le cinéma permet, signe que ce penchant qu’il autorise n’est pas encore naturalisé et accepté aussi bien par ceux qui font les films que pour ceux qui les regardent. Il y a eu aussi, avec l’arrivée du parlant, un voyeurisme et un étonnement nouveau devant ce phénomène dont le cinéma fantastique s’est fait l’écho. Lorsque l’inspecteur Lane confie à ses troupes rassemblées autour de lui qu’il a un plan pour arrêter l’homme invisible mais qu’il n’ose pas le dire, de crainte qu’il soit parmi eux à les épier, c’est autant du personnage qu’il parle que d’un autre personnage à l’existence improbable, qui est le spectateur du film, tout aussi visé par ses propos. Car s’il y a effectivement quelqu’un qui est là à l’écouter à l’ombre du plan, inconnu et invisible, c’est bien lui. Cette inquiétude justifiée de l’inspecteur au début des années trente a encore de l’avenir devant elle, pour notre plus grand plaisir.
1. Le film de Lang a été tourné en 1932 et est sorti en avril 1933. Le scénario de L’Homme invisible était achevé au moment de la sortie du film de Lang. Il s’agit donc d’une coïncidence, d’une concordance de vue, à relier avec l’apparition du phénomène du cinéma parlant.
2. « Si l’homme était demeuré normal, confiait le romancier à propos du film, nous aurions assisté à la dramatique aventure d’un héros ordinaire plongé dans une aventure hors du commun. Mais au lieu d’un homme invisible, nous avons à présent un fou invisible. »
3. Griffin le dit implicitement lorsqu’il se confie à Kemp. En cherchant le secret de l’invisibilité, il voulait faire ce que personne n’avait fait avant lui. On peut ajouter, personne sauf Dieu qui, selon les croyances admises, n’a pas besoin de la science pour arriver à cela.
4. Dictionnaire du cinéma, Les Films, Robert Laffont, « Bouquins », 1992, pp. 698-699.
5. Voir Promenades pédagogiques
6. Voir Analyse de séquence
7. Lorsqu’il est dit que l’homme invisible se voit sous la pluie ou dans le brouillard, cette affirmation va dans le sens de la technique des effets spéciaux optiques : la silhouette détourée, le système du cache-contrecache qui permet d’isoler la figure du fond, ressort de base du trucage optique, largement utilisé pour la réalisation du film.
8. Ce que le plan en plongée du même escalier réalise un peu plus tard, lorsque Griffin surprend Kemp voulant s’enfuir pour prévenir la police et qu’il le rappelle à l’ordre.
9. Lors d’une récente vision du film à la Cinémathèque française, quelques spectateurs ricanaient à la vision de ce travelling, tant le procédé leur paraissait énorme, beaucoup trop voyant. On sent en effet, à ce moment précis, la présence de la caméra sans la voir, tout comme pour l’homme invisible.
10. Voir Analyse de séquence
