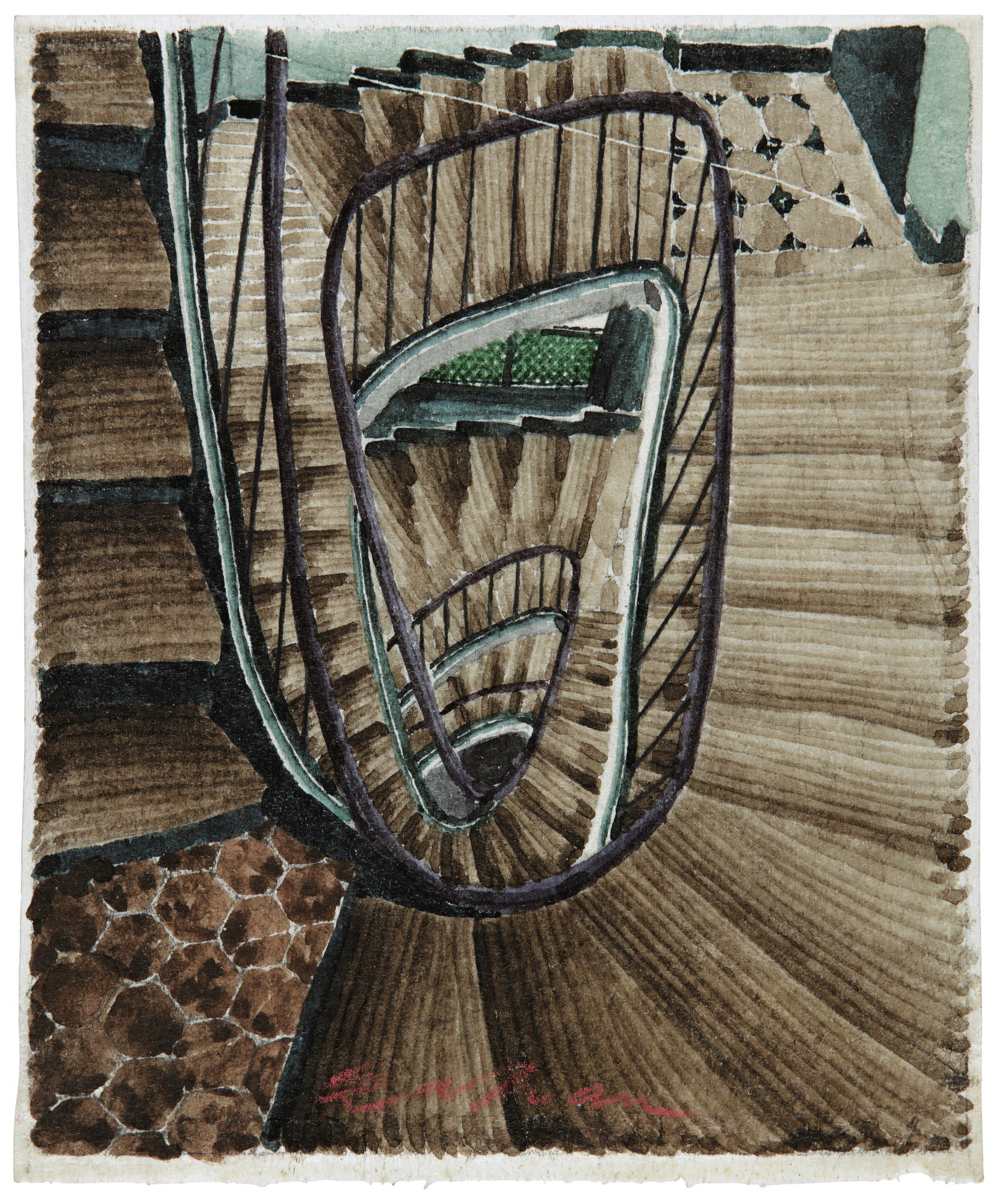
Dans la rubriqueAgrégation interne vous trouverez une bibliographie sur le langage
Cri ou parole articulée, chant ou silence, théorème ou poème, le langage est « déjà là ». A l’origine était le verbe…
Comme Le savon de Francis Ponge, le langage glisse entre les mailles du filet.
*ESSENCE DU LANGAGE
**SIGNE SIGNIFICATION ET REPRESENTATION
Théorie des signes et théorie des idées
Langage et représentation
Le langage est un code. A défaut d’être, le langage sert à... communiquer des idées.
– Hobbes Léviathan, I, 4
Signe et représentation
– Logique de Port-Royal. Art de penser De Antoine Arnauld
– Pascal De L’art de persuader et De l’Esprit Géométrique
– Foucault Michel. La Grammaire générale de Port-Royal In : Langages, 2ᵉ année, n°7, 1967. Linguistique française. Théories grammaticales. pp. 7-15 ;
doi : https://doi.org/10.3406/lgge.1967.2879
Signe et signification
– Le langage sert à communiquer les idées. Locke Essais sur l’entendement humain
LIVRE TROISIEME.
Des Mots.
Ch I. Des Mots ou du langage en général.
Ch II. De la ſignification des Mots.
Ch III. Des Termes généraux.
Ch IV. Des Noms des Idées ſimples.
Ch V. Des Noms des Modes Mixtes, & des Relations.
Ch VI. Des Noms des Subſtances.
Ch VII. Des Particules.
Ch VIII. Des Termes abſtraits & concrets.
Ch IX. De l’Imperfection des Mots.
Ch X. De l’Abus des Mots.
Ch XI. Des Remedes qu’on peut apporter aux imperfections, & aux abus dont on vient de parler.
Commentaire : [bleu]La controverse des idées abstraites Berkeley Les principes de la connaissance humaine[/bleu]
Signe, signifié, signifiant
Le langage ne se réduit pas à la langue, même s’il l’inclut. Voir le début des Cours de linguistique générale de F. de Saussure. Paris, éd. Payot, 1980
"Pour nous elle ne se confond pas avec le langage ; elle n’en est qu’une partie déterminée, essentielle, il est vrai. C’est à la fois un produit social de la faculté du langage et un ensemble de conventions nécessaires, adoptées par le corps social pour permettre l’exercice de cette faculté chez les individus. Pris dans son tout, le langage est multiforme et hétéroclite ; à
cheval sur plusieurs domaines, à la fois physique, physiologique et psychique, il appartient encore au domaine individuel et au domaine social ; il ne se laisse classer dans aucune catégorie des faits humains, parce qu’on ne sait comment dégager son unité"
– Article Pierre Caussat, « Saussure, un nouveau nominalisme ? », Linx [En ligne], 7 | 1995, mis en ligne le 11 juillet 2012. DOI : 10.4000/linx.1169
"L’histoire d’un être vivant, c’était cet être même, à l’intérieur de tout le réseau sémantique qui le rattachait au monde(...) c’est que les signes faisaient partie des choses, tandis qu’au XVIIe siècle, ils deviennent des modes de la représentation". Foucault Des mots et des choses, V, Classer, p.141, Gallimard
**SIGNIFICATION SENS ET RÉFÉRENCE. SE LIBÉRER DE LA REPRÉSENTATION ET DU SUJET
– John Stuart MILL (1843) Système de logique déductive et inductive
Exposé des principes de la preuve et des méthodes de recherche scientifique
LIVRE I : DES NOMS ET DES PROPOSITIONS
– Frege Sens et dénotation (extrait)
*Comment se libérer de la psychologie du sujet qui pense ?
- La logique doit nous libérer de la psychologisation du sujet pour dire la règle : "se libérer de l’expérience immédiate d’une conscience effective" (Cavaillès, Sur la logique, p.3, Vrin 1987)
*LA GRAMMAIRE
– Aristote Les catégories ch 4 et 5
– Kant : Voit dans la table des catégories d’Aristote une rhapsodie
– Problème de Linguistique Générale, Benveniste, Tel Gallimard, 1966 T 1et2 Voir le chapitre sur les catégories d’Aristote et la critique qu’en fait Derrida ci-dessous.
– Derrida Jacques. Le supplément de copule. La philosophie devant la linguistique. In : Langages, 6ᵉ année, n°24, 1971.
Épistémologie de la linguistique [Hommage à E. Benveniste] pp. 14-39 ;
doi : https://doi.org/10.3406/lgge.1971.2604
– Doncœur P.. Le nominalisme de Guillaume Occam. La théorie de la relation. In :
Revue néo-scolastique de philosophie. 23° année, N°89, 1921. pp. 5-25. doi : 10.3406/phlou.1921.2264
– Fontaine-De Visscher Luce. Des privilèges d’une grammatologie. In : Revue Philosophique de Louvain. Troisième série, Tome 67, N°95, 1969. pp. 461-475.
doi : 10.3406/phlou.1969.5505
– Critique de Nietzsche textes : la grammaire au service du sujet et de la métaphysique.
*LANGAGE ET REALITE
Platon réexamine l’assertion de Parménide :
On ne peut dire ou penser ce qui n’est pas.
– Euthydème 283e 284c, Platon
– Le Sophiste 261e-263d : argument sémantique qui se substitue à l’argument ontologique.
*USAGE DU LANGAGE
**Quand dire c’est agir
– Les énoncés performatifs, Austin, Quand dire c’est faire
– La rhétorique, le Gorgias, fragment B, III in les Présocratiques, trad Dumont, Gallimard, 1988
La parole persuasive
– La rhétorique génocidaire : Vaclav Havel : le langage prologue de l’événement
Dolorès Ibarruri : Contre la dictature, le fascisme et tous les despotismes, des voix célèbres ont appelé à la liberté. En 1936, c’est au cri de No pasaràn ! que Dolores Ibàrruri soulevait les foules espagnoles contre les armées fascistes du général Franco
– Sabine Luciani, « Lucrèce et la tradition de la consolation », Exercices de rhétorique [Online], 9 | 2017, Online since 20 June 2017, connection on 09 December 2018.
– La parole psychanalytique
– Rousseau : "Ceci est à moi" fonde la société civile Seconde Partie du Second Discours
– La parole agissante par Catherine Clément, BNF, 2010
Puisqu’il vient de disparaître, pensons avec lui. Personne mieux que Claude Lévi-Strauss n’a permis de comprendre l’action de la parole qui guérit sur le corps en souffrance. L’effi cacité symbolique, concept qu’il élabore dans les années cinquante pour rendre compte de la parole agissante à l’époque de son amitié avec Lacan, est comme neuf. Servons-nous en ! Il explique aussi bien la poésie de Rimbaud que les récentes avancées en neurophysiologie. Oui, la parole agit sur le corps.( présentation)
–
Dans la psychanalyse pensée par Freud, l’inconscient se libère au moyen de la parole. Lacan, à sa suite, définit pleinement la fonction de la parole en psychanalyse : héritée, scandée, vide, pleine... Par la parole, il cherche à toucher la vérité de l’inconscient.
Au programme des classes de terminale.À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Le pouvoir de la parole (3/4) : Quand dire, c’est guérir 58 MINLES CHEMINS DE LA PHILOSOPHIELe pouvoir de la parole (3/4) : Quand dire, c’est guérir
**Le langage est-il naturel ou conventionnel ?
[bleu]Exercice[/bleu]
: Les enfants sauvages
– L’expérience du médecin Itard avec Victor de l’Aveyron. A partir de cet extrait, montrer l’importance du comportement mécanique pour Itard. Il y a dans l’extrait la priorité de l’écrit sur l’oral.
– Platon, Le Cratyle
– Le conventionnalisme des sophistes
– Rousseau,Essai sur l’origine des langues
– Rousseau La langue de convention n’appartient qu’à l’homme
*Du signe au symbole
**L’homme, un animal symbolique
– Écrire et lire la poésie : parole, sens et vérité selon Gadamer et Bobin
– L’être humain comme l’« animal symbolique » chez Ernst Cassirer, Adam Westra
**Langage et signes : la communication est-elle critère de la communauté humaine ?
– Aristote, Les Politiques [environ 325-323 av. J.C.], Livre I, chapitre 2, 1253 a 8 – 1253 a 19
"« Il est évident que l’homme est un animal politique plus que n’importe quelle abeille et que n’importe quel animal grégaire. Car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain ; or seul parmi les animaux l’homme a un langage. "
– Langage et politique
Cours interactif en visio-conférence enregistré le 15/03/2012
Invité : Didier GUIMBAIL, Professeur au lycée Sonia Delaunay, à Villepreux
– Traduction et communauté politique
Pourquoi faire l’éloge de la traduction
Conférence donnée par Barbara Cassin dans le cadre des Lundis de la philosophie.
" La traduction est une manière assez peu philosophique de produire ce après quoi nous ne cessons de courir aujourd’hui, à savoir du commun. Sa méthode n’est ni synthétique ni dialectique, opérations philosophiques habituelles pour "mettre ensemble". Elle navigue entre des isolats résistants, une oeuvre en langue telle qu’en elle-même, et son analogue dans une autre langue, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Pour autant, elle ne produit pas un universel de surplomb, qui engloberait les différences comme le globish enveloppe et démobilise l’usage des cultures différentielles devenues d’exotiques idiotismes.
Je voudrais proposer un éloge de la traduction comme modèle politique. C’est une activité vieille comme le monde certes, mais que l’on considère généralement soit comme un indice de conjoncture, translatio studiorum - translatio imperii, donnez moi les chiffres des flux et je vous donnerai l’état du monde. Soit comme un indice : dites moi ce que vous pensez de la traduction et je vous dirai quel philosophe vous êtes. Je voudrais quant à moi me servir de la traduction comme d’un contre-imaginaire par rapport à ce que nous vivons au quotidien, un outil contemporain de culture et d’enseignement, bref comme une manière d’éduquer à la citoyenneté.
Je tenterais pour ce faire de réexaminer ce que j’appelle le "relativisme conséquent" à l’ère du post-truth." rg/cr/63.php] Anaïs Simon
– Il y a plus dans le symbole que dans la métaphore. La métaphore est seulement le procédé linguistique — la prédication bizarre, dans laquelle vient se déposer la puissance symbolique. Le symbole reste un phénomène bi-dimentionnel dans la mesure où la face sémantique renvoie à la face non sémantique. Le symbole est lié. Le symbole a des racines. Le symbole plonge dans l’expérience ténébreuse de la Puissance. La métaphore est seulement la surface linguistique qui doit à sa bidimentionnalité le pouvoir de relier le sémantique au pré-sémantique dans la profondeur de l’expérience humaine
Ricœur Paul. Parole et symbole. In : Revue des Sciences Religieuses, tome 49, fascicule 1-2, 1975. Le symbole. pp. 142-161 ;
doi : https://doi.org/10.3406/rscir.1975.2729
https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1975_num_49_1_2729
**La communication animale
– Koko le gorille qui parle France (1978)Réalisé par : SCHROEDER Barbet
Passage en revue des éléments à charge et à décharge sur la possibilité d’apprentissage d’un langage par les primates, et donc interrogation sur ce que montrent vraiment les images du film. -
– Sextus Empiricus A propos des animaux et de leur langage : " il n’y a pas d’absurdité à dire qu’ils discourent entre eux ; mais que nous ne comprenons pas ce qu’ils disent. Il en est à peu près comme quand nous entendons parler des étrangers, dont nous ne concevons point le langage, ne remarquant en eux qu’une voix uniforme, et non distinguée par aucune variété de prononciation."
Les Hypotyposes, 13-14
– Article Desbordes Françoise. Le langage sceptique. In : Langages, 16e année, n° 65. Mars 82. Signification et référence dans l’antiquité et au moyen âge. pp. 47-74.
doi : 10.3406/lgge.1982.1119
– Lettre au Marquis de Newcastle Descartes 23 novembre 1646
Pour Descartes, l’expression de la pensée ne se réduit pas à l’expression mécanique d’un comportement.
– Article : L’homme et le langage chez Montaigne et Descartes Frédéric de Buzon. Cet aricle est lisible en ligne après inscription en ligne.
Revue Philosophique de la France et de l’ÉtrangerT. 182, No. 4, DESCARTES ET LA TRADITION HUMANISTE (OCTOBRE-DÉCEMBRE 1992), pp. 451-466 (16 pages)
Published by : Presses Universitaires de France
– Locke distingue donc implicitement deux sortes de signes : les signes naturels, sons et gestes, qui permettent une communication rudimentaire et immédiate, et les signes artificiels, particulièrement élaborés, qui constituent le langage. Condillac développe la même idée que Locke tout en lui apportant de nouvelles précisions :
"Je distingue trois sortes de signes. 1 ) les signes accidentels, ou les objets que quelques circonstances particulières ont lié avec quelques vues de nos idées, en sorte qu’ils sont
propres à les réveiller. 2) les signes naturels, ou les cris que la nature a établis pour les sentiments de joie, de crainte, de douleur etc.. 3) les signes d’institution, ou ceux que nous avons nous-mêmes choisis, et qui n’ont qu’un rapport arbitraire avec nos idées" CONDILLAC, Essai sur l’origine des connaissances humaines, (1746), Seconde Partie Section Première
– Article : Morère Pierre.Signes et langage chez Locke et Condillac. In : Le continent européen et le monde anglo-américain aux XVIIe et XVIIIe siècles. Actes du Colloque - Société d’études anglo-américaines des 17e et 18e siècles, 1986. pp. 16-29.doi : 10.3406/xvii.1986.2235
– Habermas Jurgen."L’espace public", 30 ans après. In : Quaderni. N. 18, Automne 1992. Les espaces publics. pp. 161-191.
doi : 10.3406/quad.1992.977
– Le langage des abeilles Max von Frisch et la critique de Benvéniste :
. Ducrot Oswald. Chronique linguistique. In : L’Homme, 1967, tome 7 n°2. pp. 109- 122.doi : 10.3406/hom.1967.366889
url : /web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1967_num_7_2_366889
– Labarrière Jean-Louis. Aristote et la question du langage animal. In : Mètis.
Anthropologie des mondes grecs anciens. Volume 8, n°1-2, 1993. pp. 247-260.
doi : 10.3406/metis.1993.1000 url : /web/revues/home/prescript/article/metis_1105-2201_1993_num_8_1_1000
– Seuls les hommes disposent de leurs signes avec une inventivité permanente : étude du texte de Bergson extrait de l’Evolution Créatrice
**Une communication transparente est-elle souhaitable ?
: La communication ne se réduit pas à une transmission de codes.
– exemple : Tristan et Iseut : voile blanche/voile noire. La confusion des signes-codes
– L’idéal de transparence selon Rousseau : la pauvreté du concept. Voir Discours sur l’origine et les fondements des inégalités parmi les hommes.
– Bergson : langage, en tant que production de l’intelligence est incapable de dire le propre : fixité des mots « étiquettes » qui ne peut rendre compte du mouvement humain. Généralité qui manque le singulier. Essai sur les données immédiates de la conscience
– L’incapacité liée à la nature de l’objet : Aristote Métaphysique II, 15 : « si l’on te définissait toi par exemple.
– La métaphore construit la signification :
Aristote : La poétique, ch. 21, Rhétorique, III, 4
Armisen-Marchetti Mireille. Histoire des notions rhétoriques de métaphore et de comparaison, des origines à Quintilien.
In : Bulletin de l’Association Guillaume Budé : Lettres d’humanité, n°49, décembre 1990. pp. 333-344 ;
doi : https://doi.org/10.3406/bude.1990.1752
– La supériorité paradoxale du langage humain : la déformation du message, Revue de métaphysique et de morale 3/ 2005 (n° 47), p. 403-427 DOI : 10.3917/rmm.053.0403
– L’efficacité de l’abstraction mathématique par l’univocité de ses symboles
Pascal De l’esprit géométrique
M.Serres : Un langage sans sujet du cogito Hermès I
Leibniz et la caractéristique universelle
– Bourdieu Pierre. Sur le pouvoir symbolique. In : Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 32e année, N. 3, 1977. pp. 405-411. doi : 10.3406/ahess.1977.293828
– Bruno AMBROISE Le pouvoir symbolique est-il un pouvoir du symbolique ?
Remarques sur les contradictions du pouvoir symbolique selon P.Bourdieu
*L’indicible
– La perte du sensible : le langage comme écart et trahison du sensible, Hegel Phénoménologie de l’esprit : impossibilité de dire la chose même. Nous sommes dans la certitude sensible et nous prononçons l’universel : « ceci est ».
• Hegel et Mallarmé : l’accès à l’universel du concept : le langage change toute certitude sensible en son contraire : un concept universel. Faillite du langage qu’on peut interpréter comme une incapacité à dire la perception et le subjectif : expression ou trahison de soi. Ou bien il y a une parole vraie ou bien la parole manque pour dire l’intime et le propre.
• Mais cette faillite traduit « la nature divine » du langage. Lorsque je dis une fleur, je la désigne en instaurant une distance avec la chose, je quitte le monde des choses d’où le passage au symbolique : ce qui tient lieu de la chose. Présentation d’une réalité sensible qui suggère une signification qui la dépasse.
• Mallarmé : « je dis : une fleur et hors l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets. » dire une fleur : singularité de cette
fleur est distincte de toutes les fleurs dont j’ai l’idée. : je ne dis pas tout à fait cette fleur-ci mais je dis en même temps toutes les fleurs. Le langage est en excès et en défaut par rapport aux choses sensibles l’absente de tout bouquet : l’essence de la fleur.
**Poésie et langage : équivocité
– Sur Bonnefoy Un court article assez éclairant
– Philosophie et poésie au xxe siècle
– ELUARD, LA POÉSIE EN LIBERTÉ donné en visioconférence le 20 mars 2014
par Jean-Pierre LANGEVIN, Professeur de littérature au lycée Jean-Pierre VERNANT de Sèvres :
documents1
documents2
Projet Europe, Éducation, École
– Le langage poétique et le langage de l’image chez Eluard et Man Ray, donné en visioconférence interactive à Sèvres le 29 janvier 2015 par Jean-Pierre LANGEVIN,
Professeur de littérature au Lycée Jean-Pierre VERNANT :
textes1
textes2
Première partie : cours proprement dit
Deuxième partie : questions et discussion
EEE----
– http://www.uqtr.ca/AE/Vol_11/libre/marjo.htm Écrire et lire la poésie : parole, sens et vérité selon Gadamer et Bobin
– L’être humain comme l’« animal symbolique » chez Ernst Cassirer, Adam Westra http://www.revueithaque.org/fichiers/adepum/Westra.pdf
*Se comprendre
**Le dialogue
– les dialogues de Platon
**La conversation
Grice H. Paul. Logique et conversation. In : Communications, 30, 1979. La conversation. pp. 57-72 ;
doi : https://doi.org/10.3406/comm.1979.1446
**"L’être"naquit du langage
– Entretien avec Prochiantz Alain, « Le grand livre de la nature est œuvre humaine, inachevée/inachevable », Rue Descartes 2/ 2012 (n° 74), p. 81-98
– L’Être naquit dans le langage Un aspect de la mimésis philosophique
– Platon : Cratyle
Oeuvres philosophiques - Henri Bergson : sur le site philosophique de l’Académie de Grenoble : http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=25346 des ebooks
– Le Visible et l’Invisible (format liseuse) Maurice Merleau Ponty
L’écriture
– Cours de Jean-Pierre LANGEVIN et de Christine JAOUEN
sur LE TRAVAIL DE L’ÉCRITURE DANS MADAME BOVARY DE FLAUBERT
diffusé en visioconférence depuis le lycée J.-P. Vernant de Sèvres jeudi 18 décembre 2014 Projet Europe, Éducation, École :
textes
– Écrire sous le regard d’autrui : la dimension génétique dialogale de l’œuvre proustienne
Françoise Leriche (univ. Grenoble III) 4 novembre 2006
*La parole
– LA PAROLE Philippe Fontaine 2016 EEE
1.De la langue à la parole
2. Ce que parler veut dire
Dossier PDF
– Prendre la parole
Cours interactif en visio-conférence enregistré le 21/02/2013
Invitée : Hélène DEVISSAGUET, Professeure en CPGE au lycée Condorcet, Paris
**La parole est pensée
Philippe Touchet. Le langage et la phénoménologie Projet EEE
« Beaucoup plus qu’un moyen, le langage est quelque chose comme un être »,. Signes, Merleau-Ponty
Au contraire de la théorie du signe, la phénoménologie entend restaurer le "rapport aux choses mêmes", c’est-à-dire montrer qu’il y a bien une extériorisation du sujet, une ouverture du sujet à ce qu’il n’est pas, une épreuve du donné, qui est irréductible à tout mon pouvoir de représentation.
• Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, éd. Tel Gallimard, 1945, en particulier, le chapitre VI de la première partie, Le corps comme expression et la parole.
• Merleau-Ponty, La prose du monde, Paris, éd. Tel Gallimard, 1969.
• Merleau-Ponty, Signes, Paris, éd. Folio Gallimard, 1960.
Articles : Le langage indirect et les voix du silence ; Sur la phénoménologie du langage.
Commentaires, - Françoise Dastur, Chair et langage, Essais sur Merleau-Ponty, Fougères, éd. Encre marine, 2001, en particulier, Chair et Langage.
• Heidegger, Acheminement vers la parole, Paris, éd. Tel Gallimard, 1976.
• Heidegger, Essais et conférences, Paris, éd. Tel Gallimard, 1958, article L’homme habite en poète
– Hottois Gilbert. L’insistance du langage dans la phénoménologie post-husserlienne. In : Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, Tome 77, N°33, 1979. pp. 51-70 doi : 10.3406/phlou.1979.6032
– Le langage chez Heidegger : du discours au monologue FILLIPA SILVEIRA Université de Toulouse II – Le Mirail Erasmus Mundus EuroPhilosophie
– Fontaine-De Visscher Luce. La pensée du langage chez Heidegger. In : Revue Philosophique de Louvain. Troisième série, Tome 64, N°82, 1966. pp. 224-262. doi : 10.3406/phlou.1966.5348
– Henri Meschonnic, « Le cas Heidegger », Le Portique [En ligne], 18 | 2006, mis en ligne le 15 juin 2009, consulté le 06 août 2014.
**Conférences sur la parole
– Entre parole et musique : les langages tambourinés d’Afrique Centrale par Simha Arom CNRS
Collège de France 16 octobre 2008
– Capter la parole vive : la notation de la musique de la parole par Roger Chartier
16 octobre 2008 Collège de France
– De la parole et du bruit : l’organisation de la compréhension orale par Christian Lorenzi, ENS, CNRS, Université Paris Descartes
17 octobre 2008, Collège de France
– L’apprentissage du chant chez l’oiseau : l’importance des influences sociales par Martine Hausberger, Université de Rennes
17 octobre 2008, Collège de France
– Parole, Parole, Parole par Peter Szendy, Université Paris X Nanterre
17 octobre 2008, Collège de France
– Parole-chant : L’opéra par Claude Hagège
17 octobre 2008, Collège de France
*La traduction
Problèmes théoriques de la traduction
Marc De Launay
18/05/2015
Conférence donnée par Marc de Launay dans le cadre des Lundis de la philosophie. La traduction ne pose pas simplement des problèmes qui relèveraient de la linguistique ; on peut même constater que la réflexion sur la traduction a commencé ...
La théorie interprétative de la traduction — Izabella Badiu (univ. « Babes-Bolyai » de Cluj-Napoca)
*Dire et vouloir dire
Philosophies du langage et de l’esprit du Moyen Âge à l’époque contemporaine
Meaning and intending : philosophies of language and mind from the Middle Ages to the present
Sous la direction de Laurent Cesalli et Claudio Majolino
Que veut dire vouloir dire ? Les contributions réunies dans ce numéro s’intéressent à différentes réponses données à cette question du Moyen Âge à nos jours. Le problème du vouloir dire est au cœur des efforts d’élucidation de ce phénomène à la fois quotidien et impénétrable qu’est le langage. Il y a (au moins) deux raisons à cela : d’une part, la question de savoir ce que veut dire ‘vouloir dire’ vise la notion de signification, notion dont on peut dire sans exagérer qu’elle est la préoccupation centrale de la philosophie du langage ; de l’autre, cette question appelle un certain nombre de distinctions qui révèlent la nécessité de prendre en compte conjointement, dans la théorie de la signification, des éléments qui relèvent non seulement de la philosophie du langage, mais encore de la philosophie de l’esprit.
*Langage et cinéma
– Blow Out de Brian de Palma est un film sur la manipulation sonore. Mais c’est aussi un film sur l’écoute. Précisément, ce que le film montre, c’est à quel point la manipulation sonore peut modifier le sens de notre écoute. Exemple avec un même son qui revient à plusieurs reprises dans le récit avec, à chaque fois, un sens différent. Extrait
– Libero de Réalisé par : ROSSI STUART Kim 2006
extrait : la prise de parole
Après le retour surprise de Stefania (la mère), Renato réveille Viola et Tommaso (Tommi) pour tenir un conseil de famille « démocratique »…
Dans cette séquence, située vers le premiers tiers du film (à 30’ environ), aucune prouesse technique, mais un découpage classique organisé autour du personnage central, Renato, dont la parole surabondante semble dominer à la fois la famille et la séquence. Plus qu’un affrontement entre le père et la mère ou la fille, c’est à un jeu de regards que nous assistons, dont le centre est cette fois Tommaso qui, d’une seule phrase met à nu la machination montée par Stefano
– la NOVLANGUE - "1984" de George Orwell
– Le Discours d’un roi (2010) Tom Hooper
dossier pédagogique
[rouge]Pour accéder au film il faut se connecter sur Eduthèque[/rouge]
De The Queen (Stephen Frears, 2006) à The Crown (Peter Morgan, 2016), la famille royale britannique ne cesse d’inspirer cinéastes et auteurs de séries. Tom Hooper avait déjà signé une minisérie consacrée à Élisabeth Ire en 2005. Son film Le Discours d’un roi (2010) raconte comment Albert, dit « Bertie », duc d’York devenu roi malgré lui en 1937 suite au décès de son père George V et à l’abdication de son frère Edward VIII, a surmonté son bégaiement grâce à Lionel Logue, orthophoniste autodidacte d’origine australienne. Le film commence et se termine par un discours mais traite en réalité de l’amitié orageuse qui lia les deux hommes, l’altesse royale qui refusait d’être appelée par son diminutif et le docteur qui s’obstinait à ne pas respecter les règles de bienséance et à user de méthodes peu conventionnelles. Pour délier la langue de son patient, il l’incitait notamment à débiter des chapelets de jurons qui ont valu au film une interdiction aux moins de 17 ans aux États Unis…
En France, le film a été un succès – plus de 3 millions de spectateurs après 33 semaines d’exploitation – même si la part la plus cinéphile de la critique lui a reproché son académisme et a vu dans l’oeuvre de Tom Hooper une « machine à Oscars » (Les Cahiers du cinéma) conçue par les frères Weinstein plus qu’un film d’auteur.
